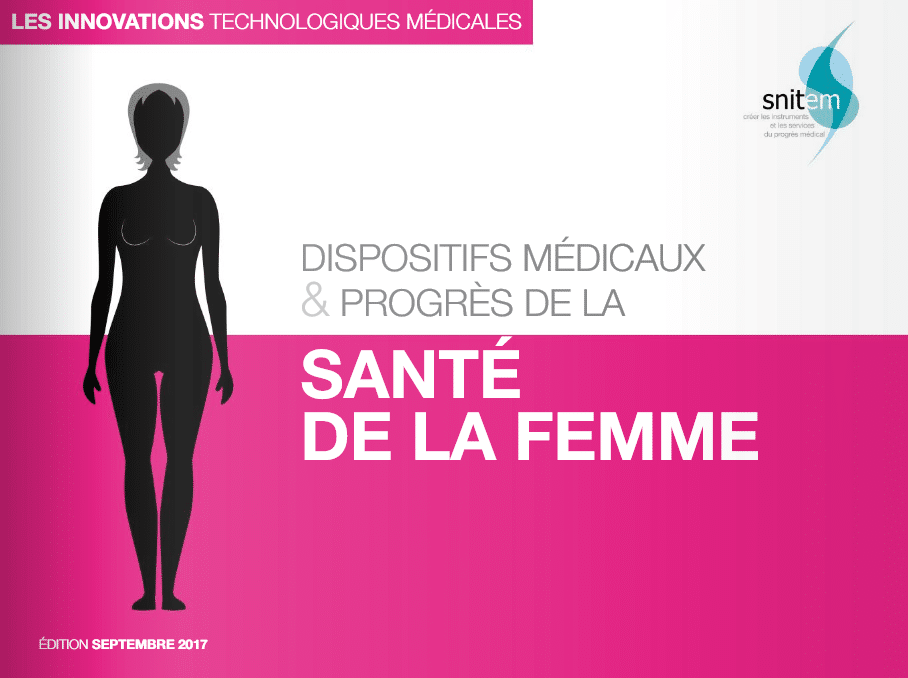Livret santé de la femme
Préfacé par le Professeur Bernard Hédon, le Livret Santé de la femme présente les très nombreuses innovations technologiques qui ont changé la prise en charge des pathologies féminines.
1. Préface du Pr Bernard Hédon
Une médecine à part entière, mais si particulière
Professeur Bernard Hédon, Gynécologue-obstétricien Professeur de Gynécologie-obstétrique à la Faculté de médecine de Montpellier (Université de Montpellier) Ancien Président du Collège national de gynécologie-obstétrique (CNGOF)
La santé de la femme demande une vigilance particulière de la part de notre société humaine. N’est-elle pas « l’avenir de l’Homme » en raison de sa place dans la procréation et pour la santé des générations futures ? N’est-elle pas plus fragile que son compagnon masculin ? Ce cliché est faux à bien des égards mais les femmes sont concernées par des pathologies qui leur sont propres et qui nécessitent une approche médicale spécifique. Je suis honoré, qu’en tant que gynécologue-obstétricien et ancien Président du Collège national de gynécologie-obstétrique, d’avoir été invité à préfacer cet ouvrage sur les innovations technologiques médicales concernant la santé de la femme. Le gynécologue-obstétricien a choisi cette spécialité médicale pour se consacrer aux femmes et à leur santé. Le Collège national s’est donné comme slogan « Tout pour la santé de la femme », ce qui lui sert aussi de logiciel de réflexion pour émettre ses avis. Si c’est bon pour la santé de la femme, l’avis est favorable. En revanche, si cela doit mettre en danger la santé de la femme, l’avis ne peut être que défavorable.
On entend dire que la femme est le parent pauvre de la recherche et des avancées médicales parce que la société est dirigée par les hommes. J’ai toujours trouvé cette opinion fausse et injuste. Elle ignore en effet la féminisation, aujourd’hui majoritaire, de nos professions de médecin et de chercheur. Elle fait fi des avancées extraordinaires réalisées dans tellement de domaines de la santé de la femme : la contraception, le diagnostic prénatal, l’hormonologie, la prévention des cancers (cancer du col), le diagnostic précoce par dépistage organisé (cancer du sein), la fécondation in vitro, la chirurgie conservatrice et réparatrice révolutionnée par l’approche endoscopique, le souci du bien-être intime… La liste est longue et non exhaustive.
C’est pourquoi cet ouvrage est particulièrement bienvenu. Il illustre à la perfection que la médecine de la femme est une médecine à part entière, avec les mêmes codes, les mêmes procédures, les mêmes besoins technologiques, la même recherche constante de la qualité et de la bientraitance que n’importe quelle autre spécialité médicale. Mais que c’est aussi une médecine particulière dans le sens où elle traite souvent de sujets intimes, voire tabous, qui nécessitent une approche adaptée. Le respect de la personne et de son corps ainsi que le consentement éclairé qui sont une règle générale en médecine revêtent ici encore plus d’importance. La gynécologie-obstétrique est parfois accusée d’être une médecine violente, s’agissant notamment de l’obstétrique. Hors de toute polémique stérile et méprisable, reconnaissons qu’elle l’est
parfois, pour des raisons d’urgence, tant pour la mère que pour son enfant. Faisons en sorte qu’elle ne le soit pas pour d’autres raisons, le stress du praticien étant une explication mais non une excuse. La technologie doit nous y aider et le lecteur verra dans cet ouvrage de nombreux exemples qui le démontrent. Mais, comme toujours, les progrès techniques doivent aussi s’accompagner de progrès humains. C’est ainsi que la médecine se pratique et c’est ainsi que la santé de la femme sera le mieux prise en compte.
La réflexion critique doit aussi être une constante. Une innovation ou un progrès technologique, ne peut être considéré comme un progrès réel qu’après que la preuve ait été faite qu’il est réellement utile et qu’il améliore la prise en charge de la santé de la femme. Les exemples sont nombreux de progrès apparents, qui s’avèrent néfastes en pratique, avec une balance bénéfices/risques insuffisante ou mal maîtrisée. Cet esprit d’autocritique doit s’appliquer à nous, médecins, et nous devons rester vigilants, mais aussi aux autorités de régulation ainsi qu’aux patientes elles-mêmes. Les règles administratives, censées protéger les patientes de prises en charge dont l’innocuité n’est pas démontrée, créent parfois des situations qui privent les femmes de progrès réels validés par la littérature. Les raisons économiques souvent, juridiques parfois, aboutissent à des retards d’application non éthiques quand on se place du côté des femmes et de leur santé. Quant aux patientes elles-mêmes, parfois manipulées par des avocats qui s’en font une spécialité, par réseaux sociaux et médias interposés, elles arrivent à faire prendre aux politiques des décisions qui dépassent le cadre scientifique et qui sont parfois la cause de reculs et non de progrès pour la santé des femmes. L’esprit de responsabilité doit être partagé, tous ayant quelque chose à dire, mais chacun à sa place avec son approche spécifique, dans l’écoute et le respect mutuel.
Et dans le futur ? Sur quoi porteront les prochaines innovations ? L’exercice de la boule de cristal est périlleux. Qui avait prévu les progrès inouïs réalisés dans la prise en charge de l’infécondité et la prévention de la transmission des anomalies génétiques grâce aux techniques de procréation assistée ? Qui aurait prédit que l’endoscopie gynécologique connaitrait de telles avancées et qu’elle serait une véritable révolution dépassant très largement la sphère gynécologique pour s’appliquer aussi à la chirurgie viscérale et digestive ? Il faut savoir regarder au-delà de ce que nous savons et changer de paradigme. L’imagerie n’a pas fini de nous étonner et de nous servir. Ne la transformons pas en dictature. Restons prudents avec les matériels prothétiques, les qualités des tissus humains n’étant encore qu’imparfaitement imitées et reproduites. Risque-t-on de se tromper en prédisant que le futur s’inscrira davantage dans la prévention et le dépistage que dans de nouvelles avancées thérapeutiques ? Ces dernières sont encore nécessaires, notamment pour des affections telles que l’endométriose qui peuvent être tellement handicapantes et, malgré les progrès réalisés, encore imparfaitement prises en charge. Souhaitons-le pour la santé de celles qui en souffrent. Mais pour la grande majorité des femmes, les progrès pour leur santé viendront de la prévention : lutte contre le fléau du tabagisme, prévention des conséquences du surpoids et de l’obésité, vaccination préventive du cancer du col, hygiène de vie diminuant le risque de cancer du sein, contraception adaptée et individualisée, préparation à la grossesse et à la maternité, accompagnement matériel et humain dans les situations de grande précarité psychologique ou sociale… : la liste est longue et la tâche immense. La santé de la femme doit beaucoup aux innovations et aux progrès techniques. Elle est aussi tributaire du dévouement quotidien et de l’attention sans relâche de tous ceux qui ont décidé de lui dédier leur exercice professionnel. Cela dépasse largement la profession de gynécologue-obstétricien et implique de nombreuses autres spécialités médicales, les sages-femmes, les psychologues, les responsables de santé publique jusqu’aux journalistes, responsables politiques, etc.
Cet ouvrage fait le point sur ce qui existe à ce jour. Savourons-le pour tous les sujets qu’il aborde de façon à la fois documentée et synthétique. Sachons surtout lui donner une suite et relever le défi de l’innovation qui ne s’arrête jamais, surtout quand c’est pour une cause aussi noble que celle de la santé de la femme.
2. La santé de la femme, l’objet d’une science à part entière
Négligée pendant des siècles, la santé de la femme est enfin au cœur des préoccupations. Ces dernières décennies, les disciplines de gynécologie et d’obstétrique – devenues sciences à part entière – ainsi que la prise en charge des pathologies féminines ont connu d’incroyables progrès.
Au cours de sa vie, différents épisodes jalonnent la vie d’une femme, nécessitant des dispositifs adaptés : suivi et examens, contraception, grossesse, accouchement et post-partum, maladies, ménopause… La gamme de dispositifs actuellement disponibles répond désormais au mieux aux besoins des femmes. Surtout, les dispositifs existant aujourd’hui pour le suivi et la prise en charge des femmes permettent de tenir compte et de s’adapter à chaque situation, à chaque histoire.
Miniaturisation, robotisation et médicalisation
La miniaturisation, la robotisation et l’apport du numérique ont grandement participé au perfectionnement des instruments nécessaires au suivi et aux différents examens gynécologiques, notamment exploratoires. Ainsi en est-il de la laparoscopie et de l’hystéroscopie, examen fondamental dans la prise en charge des femmes, qui a connu une grande évolution au cours des trente dernières années. Les progrès réalisés en imagerie ont en effet permis d’assurer un meilleur suivi des femmes au quotidien, mais aussi durant la grossesse, notamment par le biais de l’échographie. Dans la prise en charge de la grossesse et de la naissance, l’évolution des techniques et des équipements (maturation cervicale, péridurale, extraction, hémorragie du post-partum…) a fait gagner en confort et surtout en sécurité pour la mère comme pour l’enfant. Des progrès que certains nuancent néanmoins, pointant une certaine hypermédicalisation actuelle de la grossesse et de l’accouchement. Celui-ci est d’ailleurs passé, hier, d’un art pratiqué exclusivement entre femmes initiées à une véritable science médicale, aujourd’hui. Les progrès technologiques et médicaux ainsi que l’évolution des mentalités font qu’aujourd’hui, en France, les femmes peuvent maîtriser leur fécondité, notamment grâce aux dispositifs intra-utérins. En matière de traitement de l’infertilité, également, les progrès ont été très importants comme pour la fertiloscopie. En somme, les dispositifs médicaux désormais disponibles redonnent sa place au traitement chirurgical de l’infertilité.
Prise en charge des pathologies : préservation et qualité de vie
La vie d’une femme peut également être jalonnée d’épisodes douloureux et traumatiques. C’est notamment le cas des cancers du sein et de l’utérus, les plus répandus chez les femmes (voir encadré). Les progrès réalisés en matière de dépistage et de soin de ces cancers sont eux aussi révélateurs de l’incroyable dynamisme dans la prise en charge de la santé féminine. En effet, les traitements anti-cancéreux sont aujourd’hui de moins en moins invasifs et agressifs. Plus ciblés, ils sont également moins irradiants, voire fractionnés en cycles et nécessitent moins de séances. De manière générale, les traitements des pathologies féminines sont de plus en plus conservateurs afin de préserver au mieux l’intégrité du corps féminin. En cas de fibromes, par exemple, la solution privilégiée fut longtemps l’ablation de l’utérus. Désormais, les innovations technologiques permettent dans la plupart des cas de conserver l’utérus et donc la possibilité de porter un enfant. En outre, les progrès dans le suivi et la prise en charge des femmes, qui ont notamment diminué l’invasivité des examens et des interventions tout en gagnant en précision, ont amélioré la qualité de vie. Le développement de l’ambulatoire a également
participé de cette évolution.
La santé des femmes dans le monde
Le droit des femmes à jouir d’une santé mentale et physique du meilleur niveau a été reconnu lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, à Beijing, en 1995.
Y a été affirmée la nécessité de garantir aux femmes et aux filles un accès universel à des soins et des services de santé appropriés, abordables et de qualité. Néanmoins, malgré cet engagement, d’énormes progrès restent à faire en matière d’égalité d’accès aux soins notamment.
A titre informatif, dans le monde, le cancer du sein est le plus meurtrier chez les femmes âgées de 20 à 59 ans. Le deuxième est le cancer du col de l’utérus, la quasi-totalité des cas étant liés à une infection génitale par le papillomavirus humain, à transmission sexuelle. A noter également que les décès maternels sont la deuxième cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer, la quasi-totalité de ces décès survenant dans les pays en voie de développement.
(Source : ONU, OMS)
3. Examen gynécologique
Pour une intrusion toujours moindre
Aucun examen médical n’est anodin mais l’examen gynécologique, en ce qu’il touche au plus intime du corps, est particulièrement délicat. Le spéculum en est devenu aujourd’hui l’élément clé, tant sur le plan diagnostique que chirurgical.
De manière générale, le spéculum est un outil de diagnostic utilisé dans diverses spécialités médicales et permettant d’agrandir et de maintenir grandes ouvertes certaines cavités naturelles (nez, oreille, vagin, rectum…) afin de pouvoir mieux en examiner l’intérieur. En gynécologie-obstétrique spécifiquement, il maintient ouverte la cavité vaginale pour l’examen, pour bien voir les parois et les culs-de-sac du vagin ainsi que le col de l’utérus. Les prescriptions du spéculum sont très nombreuses. Ce dispositif permet notamment de pratiquer des examens (hystéroscopie, fertiloscopie, amnioscopie, colposcopie), de procéder à la pose d’un Dispositif intra-utérin (DIU) et de détecter des lésions (infections, inflammations, traumatismes, tumeurs) ou l’origine d’un saignement génital. Il permet en outre de procéder à des prélèvements, des frottis, des curetages et des biopsies. Enfin, le speculum est un dispositif nécessaire dans le cadre de nombreuses interventions chirurgicales (polypectomie…).
Ressemblant à une sorte de bec de canard, on l’insère dans le vagin dont il écarte les parois. Le spéculum est aujourd’hui en métal (et donc stérilisable) ou en plastique (à usage unique). Il comporte deux valves qui peuvent être démontables ou indémontables. Sa taille est adaptable selon la patiente, l’examen et ce que l’on cherche à observer.
Si l’on trouve des traces d’instruments s’apparentant aux spéculums dans l’Egypte ancienne, ce fut surtout dans la Grèce et la Rome antiques qu’ils furent utilisés à des fins d’examen gynécologique. C’est d’ailleurs de cette époque que ce dispositif (également appelé dioptre) tire son nom, « speculum » signifiant miroir en latin. Ainsi des spécimens en bronze composés de trois valves mobiles furent retrouvés dans les vestiges des sites de Pompéi et d’Herculanum. Il fallait, à l’époque, lubrifier et réchauffer le spéculum puis en introduire les tiges dans le vagin de la patiente. Le même dispositif à trois valves était encore utilisé au Moyen-Âge. On en trouve notamment la trace au XVIe siècle, dans certains écrits d’Ambroise Paré. Les premières représentations de spéculum bivalve datent du XVIIe siècle. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître « un instrument plus parfait » dans sa forme (valves plus larges et plus longues), « mais le mécanisme à l’aide duquel est fait l’écartement est entièrement le même » peut-on lire dans le Traité des maladies des femmes qui déterminent des fleurs-blanches, des leucorrhées ou tout autre écoulement utéro-vaginal (H. Blatin et V. Nivet, 1842). Il fallait bien entendu associer une source de lumière (bougie, notamment).
Entrée dans la modernité
C’est au début du XIXe siècle que se produisit une évolution majeure dans l’instrumentation dédiée à l’examen gynécologique. Un médecin français, Joseph Claude Anthelme Récamier, mit au point un dispositif rompant avec les écarteurs utilisés depuis l’Antiquité : « le spéculum simple dont M. Récamier est l’inventeur, n’est autre chose qu’un tube métallique, arrondi, un peu conique, dont le sommet est tronqué et la partie évasée coupée obliquement, ce qui permet de saisir cet instrument entre le pouce et les autres doigts quand on veut l’appliquer », poursuit le traité. Il était en étain dont le « polissage augmente la luminosité intravaginale sans toutefois dispenser ni de la bougie ni du réflecteur », explique Claude Renner (A propos du spéculum d’étain de Récamier, Histoire des sciences médicales, tome XL, 2006). Néanmoins, d’autres matériaux furent imaginés : bois, caoutchouc durci, cristal, verre ou porcelaine lorsqu’un matériau non métallique était nécessaire dans le cadre de l’électrothérapie par exemple. Toutefois, l’étain resta le matériau de référence pendant plus d’un siècle. Il fut amélioré dans les années qui suivirent (ajustement aux dimensions du vagin, ajout d’une poignée, changement de forme de l’extrémité vulvaire…). Deux facteurs propres furent fondamentaux dans la diffusion du spéculum. Le XIXe siècle fut marqué par la propagation des maladies vénériennes dans les grandes villes d’Europe. Ce dispositif permettant d’en faire le diagnostic, il se répandit dans les hôpitaux, les prisons et les dispensaires. A Paris, particulièrement, où les prostituées furent mises en carte, c’est-à-dire répertoriées dans un fichier par la police, « la Préfecture de Police de Paris impos[a] [le spéculum] pour [leur] surveillance des prostituées », poursuit Claude Renner.
En outre, à cette époque, le rôle des sages-femmes devint de plus en plus important. Elles contribuèrent à le diffuser, certaines d’entre elles jouant même un rôle très actif dans l’évolution du dispositif. Il faut notamment souligner l’apport de Madame Boivin qui est à l’origine du spéculum bivalve. Cette invention révolutionna le dispositif et est à l’origine de tous les spéculums actuels. L’américain Sims introduisit ensuite le principe du bec de canard sur lequel repose l’instrument que l’on connaît aujourd’hui. En 1870, Thomas Graves lui donna sa forme définitive. Petit à petit, et parallèlement aux progrès réalisés dans les autres spécialités médicales, le spéculum ne fut plus seulement utilisé pour observer et examiner. En effet, avec le développement des interventions chirurgicales, le spéculum entra dans la salle d’opération où il permit aux chirurgiens de maintenir ouverte la cavité durant l’intervention.
Néanmoins, si sa forme changea peu au cours du XXe siècle, un travail fut mené sur le matériau. Ainsi, il en existe désormais à usage unique, en plastique. Cette matière est souvent plus appréciée des patientes (car moins froide que le métal). Ainsi, au fil des siècles, les efforts portés sur le spéculum visent à rendre l’examen gynécologique le moins désagréable possible.
Assise ou couchée ?
Dans l’Antiquité et jusqu’au XVIIe siècle, l’examen gynécologique relevait de la compétence exclusive des femmes et était pratiqué par les sages-femmes. Jusqu’au XIXe siècle de nombreux médecins fondaient leurs prescriptions sur les seules paroles de leurs patientes ! Du côté de la position, la femme a longtemps réalisé l’examen debout. Au cours du XIXe siècle, on se mit à pratiquer l’examen en position allongée grâce au spéculum. Aujourd’hui, l’examen gynécologique est le plus souvent pratiqué à plat-dos, les pieds calés dans les étriers de la table d’examen, même s’il existe des alternatives (sans étrier, position du lotus…).
4. Hystéroscopie
Voyage au cœur de l’utérus
L’hystéroscopie a permis d’observer l’intérieur de l’utérus jusqu’à pouvoir aujourd’hui en traiter les lésions de manière toujours moins traumatisante pour les patientes.
L’hystéroscopie (du grec « hystéro » qui signifie « utérus » et « scopie » qui veut dire « regarder ») est une endoscopie permettant de visualiser l’intérieur de la cavité utérine et éventuellement d’en traiter les lésions constatées. « En gynécologie, l’hystéroscopie est le nerf de la guerre, explique le Pr Hervé Fernandez, chef du service Gynécologie-obstétrique de l’Hôpital Bicêtre. Ce système permet d’introduire une caméra dans l’utérus par le col afin d’observer la cavité utérine. L’hystéroscopie peut être diagnostique ou opératoire. » L’hystéroscopie diagnostique est réalisée en ambulatoire lors d’une consultation et est prescrite pour la recherche d’anomalies de la muqueuse utérine (synéchie, polype, fibrome, cancer). Dans le cadre opératoire (fibromes responsables de métrorragies ou de ménorragies, polype bénin de la cavité utérine, épaississement anormal de l’endomètre, malformation utérine, synéchies utérines) cependant, elle est couplée à de la chirurgie et réalisée sous anesthésie générale ou locorégionale. Selon l’indication, l’hystéroscopie peut donc désigner une technique d’examen et/ou une technique chirurgicale.
Toute hystéroscopie se pratique par les voies naturelles et nécessite, dans un premier temps, l’injection d’un liquide ou d’un gaz (du sérum physiologique ou du CO2 pour l’hystéroscopie diagnostique et du glycocolle ou du sérum physiologique en cas d’hystéroscopie opératoire) en petite quantité dans la cavité utérine au travers du col. Et ce, afin d’entraîner la distension de la cavité et la séparation des parois utérines pour en permettre la visualisation à l’aide d’une lumière froide et d’un système vidéo permettant le contrôle sur un moniteur par le gynécologue. Dans un cadre diagnostique, l’hystéroscope introduit est un système optique, rigide ou flexible, d’un diamètre d’environ 3 mm. Lors d’une hystéroscopie opératoire en revanche, le diamètre du dispositif utilisé est plus grand (entre 5 et 10 mm environ). Outre l’optique, le dispositif est agrémenté d’instruments permettant l’intervention comme, un bistouri électrique, par exemple, dans lequel passe un courant électrique de section qui permet de couper sous contrôle de la vue et d’un tunnel à double voie par lequel arrive et repart le liquide.
L’histoire de l’hystéroscopie est intimement liée à celle de l’endoscopie. En la matière, « la gynécologie fait d’ailleurs figure de précurseur, souligne le Dr Eric Leblanc, chef du département de cancérologie gynécologique du Centre Oscar Lambret à Lille. Les innovations en gynécologie ont influé sur les techniques utilisées aujourd’hui en chirurgie digestive et urologique. » L’intérieur du corps humain et, plus spécifiquement, celui du ventre des femmes a concentré l’attention des hommes depuis les temps les plus reculés. Diverses techniques furent expérimentées pour l’explorer : spéculums pour en faciliter l’accès, systèmes d’éclairage (soleil, jeu de miroirs, chandelles etc.). Néanmoins, il fallut attendre le XIXe siècle pour qu’apparaissent des dispositifs dédiés à l’hystéroscopie. Le premier, permettant de voir l’intérieur de la cavité utérine par réflexion de la lumière extérieure, a été mis au point par l’Allemand Bozzini entre 1804 et 1807. Le dispositif fut amélioré, en particulier en matière d’éclairage, grâce à l’apport du chirurgien français Antonin-Jean Desormeaux qui inventa officiellement l’endoscope en 1853 puis grâce à l’invention du polyscope en 1873, un endoscope muni d’une lampe à incandescence (voir le livret consacré à l’appareil digestif). En matière de gynécologie plus spécifiquement, le premier examen hystéroscopique fut pratiqué par Pantaleoni en 1869 chez une patiente présentant des saignements post-ménopausiques. Il réalisa également la première cautérisation d’un polype utérin au nitrate d’argent. Néanmoins, si ces dispositifs permirent de faciliter l’examen gynécologique, en matière d’intervention, la laparotomie, qui consiste à ouvrir l’abdomen, restait l’unique voie d’abord.
Une histoire d’éclairage
Il fallut ensuite attendre plusieurs décennies pour voir apparaître des innovations significatives en matière d’hystéroscopie et pour que cet examen ne soit réellement codifié. Ainsi, dans les années 50, l’invention des câbles de fibre optique autorisa la mise au point des fibroscopes et des endoscopes complétement flexibles donc plus faciles à introduire. L’éclairage connut lui aussi une révolution en 1960 lorsque fut utilisée une source de lumière froide pour observer les cavités du corps sans danger. Ses avantages ? Une lumière puissante mais qui dégage peu d’énergie thermique et donc de chaleur. Ces dispositifs ne facilitèrent pas seulement l’exploration de l’utérus : ils permirent également d’effectuer des gestes opératoires qui étaient auparavant réalisés par laparotomie. Dans les années 80, la mise au point de la lumière froide à fibre optique, le perfectionnement de la vidéo et des caméras et, surtout, l’avènement de la cœlioscopie marquèrent une véritable révolution et un tournant opératoire. Ainsi, le Dr Jacques Hamou mit au point le premier hystéroscope rigide associé à une distension gazeuse en 1981.
La révolution cœlioscopique
Dès lors, les premières interventions par voie cœlioscopique (ou laparoscopique) purent être menées en gynécologie, notamment pour traiter les grossesses extra-utérines puis les kystes aux ovaires. Cette technique consiste à explorer la cavité abdominale grâce à un endoscope rigide doté d’un oculaire sur lequel s’adapte une caméra que l’on introduit par un petit orifice. Dès les années 90, « l’hystéroscopie diagnostique et opératoire devint une routine », précise le Pr Fernandez. Les nouvelles technologies vinrent également la perfectionner : « L’arrivée des caméras avec des pompes permirent d’acheminer du liquide dans la cavité utérine et d’améliorer la visualisation, poursuit le spécialiste. En outre, l’apport de l’énergie bipolaire rendit possibles les interventions. La miniaturisation des optiques a également joué un rôle fondamental. » Dès lors, grâce à la miniaturisation, l’hystéroscopie est devenue de moins en moins invasive et, de fait, moins traumatisante pour les patientes tout en gagnant en précision jusqu’à pouvoir être, aujourd’hui, réalisée en
ambulatoire dans sa visée diagnostique. Et le Pr Fernandez de conclure : « Certes, il restera toujours un risque mais les progrès réalisés en matière d’hystéroscopie, notamment celui de ne plus avoir à ouvrir systématiquement nos patientes, ont permis de diminuer de manière impressionnante la morbidité. »
Fonctionnement de l’utérus
L’utérus est un organe musculaire et creux appartenant au système reproducteur de la femme. Située en arrière de la vessie et en avant du rectum, cette poche a pour fonction d’accueillir la nidation et le développement de l’œuf fécondé. De forme globalement triangulaire, sa pointe est dirigée vers le bas où se trouve le col de l’utérus, fermé par un bouchon de mucus épais qui devient mince et perméable au sperme au moment de l’ovulation. L’extérieur de l’utérus est constitué d’un muscle lisse, le myomètre. La paroi interne, l’endomètre, est une muqueuse très sensible aux hormones ovariennes dont l’épaisseur varie au cours du cycle menstruel. Sur le côté se trouvent les trompes de Fallope, sorte de conduits qui mènent aux ovaires.
Hystérectomie : quand l’ablation est inévitable
Pour traiter certaines pathologies, on doit parfois recourir à l’hystérectomie (ou ablation de l’utérus) s’il n’existe pas d’autre alternative ou en cas d’échec du traitement médicamenteux. C’est notamment le cas pour traiter certains cas de fibrome, d’endométriose, de cancer (col utérin, endomètre, ovaires ou trompes) ou de prolapsus génital. Il existe quatre types d’hystérectomie possibles, selon le problème et l’âge de la patiente :
- L’hystérectomie subtotale qui consiste à enlever le corps de l’utérus mais à garder le col utérin.
- L’hystérectomie totale lors de laquelle sont ôtés le corps et le col de l’utérus.
- L’hystérectomie totale avec annexectomie qui consiste à enlever les annexes de l’utérus (trompes de Fallope et ovaires) en plus de son corps et de son col. Chez la femme non ménopausée sans contexte cancéreux mammaire ou ovarien, l’annexectomie peut être remplacée par la salpingectomie bilatérale seule (ablation des deux trompes et de l’utérus mais préservant les ovaires). Ce geste a pour but de prévenir du cancer épithélial de l’ovaire dont on sait maintenant que son origine la plus probable serait les trompes de Fallope.
- L’hystérectomie radicale n’est pratiquée que pour des cancers du col invasifs. Elle associe à l’hystérectomie totale l’ablation d’une partie plus ou moins étendue des paramètres (tissus cellulo-lymphatiques situés de chaque côté du col et du corps de l’utérus au sein desquels peuvent avoir diffusé des cellules tumorales). On lui associe aussi l’ablation de la partie haute du vagin. L’ablation des ovaires dépendra du type de tumeur, de son stade et de l’âge de la patiente. A noter que pour des femmes très jeunes et sous certaines conditions, une variante a minima de ce traitement permet de préserver la fertilité. Dans tous les cas, ce geste radical est précédé de l’ablation des ganglions lymphatiques pelviens (de plus en plus guidée par l’ablation du ganglion sentinelle (premier relais ganglionnaire possiblement atteint et repéré par des colorants spéciaux) dont l’atteinte témoignerait d’une dissémination loco-régionale de la maladie. Celle-ci impose alors un changement de stratégie thérapeutique au profit d’une radio/chimiothérapie. Enfin, il existe trois voies d’abord chirurgicales qui dépendent, là encore, de la pathologie et de la patiente : hystérectomie par laparotomie ou par voie haute (ouverture de l’abdomen), hystérectomie vaginale ou par voie basse (intervention réalisée par les voies naturelles au moyen d’une incision située au fond du vagin) ou hystérectomie cœlioscopique (grâce à la cœlioscopie, l’utérus est libéré de ses attaches avant d’être extrait par le vagin). L’avènement de la chirurgie assistée d’un robot chirurgical a permis, en 2006, d’effectuer la première hystérectomie radicale laparoscopique assistée d’un robot.
5. Fertiloscopie et traitement de l’infertilité
Remédier aux anomalies de fertilité
La fertiloscopie permet de constater puis de traiter les anomalies de l’appareil reproducteur féminin et de remédier à l’infertilité grâce à la chirurgie. Tout comme l’hystéroscopie, elle a bénéficié des progrès de la cœlioscopie ainsi que de la miniaturisation des dispositifs médicaux.
En cas de problème de fertilité, on peut procéder à une fertiloscopie, à savoir l’exploration de l’ensemble des organes génitaux internes de la femme (utérus, trompes, ovaires, intérieur de l’abdomen situé à proximité de ces organes). Elle offre un état des lieux très poussé de l’appareil reproducteur féminin. Aussi précise que la cœlioscopie dont elle est une alternative, elle présente néanmoins les avantages d’être moins invasive. Selon les résultats obtenus, il est plus aisé de choisir l’option thérapeutique la plus adaptée au cas de la patiente : fécondation in vitro, chirurgie, insémination. La fertiloscopie permet en outre de réaliser des interventions comme le traitement de certains cas d’endométriose de stade 1 dans le cul-de-sac recto-vaginal ou utéro-réctal de Douglas ou du syndrome des ovaires micropolykystiques par drilling ovarien « qui consiste à faire des trous dans les ovaires afin de permettre l’ovulation », précise le Pr Hervé Fernandez, chef du service de Gynécologie-obstétrique de l’Hôpital Bicêtre.
La fertiloscopie est une technique chirurgicale mini-invasive et peut se pratiquer sous anesthésie locale ou avec une courte anesthésie générale. Elle consiste à introduire un fertiloscope (dispositif muni d’une caméra miniaturisée) par les voies naturelles afin de recueillir des renseignements sur d’éventuelles anomalies touchant les organes reproducteurs et, éventuellement, de les traiter.
Si la question de la stérilité est aussi vieille que celle des naissances, il fallut attendre le XXe siècle pour voir apparaître des techniques susceptibles d’y pallier. En cas d’infertilité, la seule option possible, à l’époque, consistait à procéder à une laparotomie, c’est-à-dire à l’ouverture de l’abdomen de la patiente, sans connaître l’étendue des lésions ni, par conséquent, savoir si l’on pourrait les traiter. A l’aune de ce constat, et sur la base des progrès réalisés en matière d’endoscopie au cours du siècle précédent, le Français Raoul Palmer, chirurgien gynécologue spécialisé dans le traitement des stérilités féminines, chercha dans les années 30 et 40 « le moyen d’en savoir plus, avant l’opération réparatrice proprement dite », explique Gilbert Schlogel dans « Raoul Palmer et l’aventure coelio-chirurgicale de 1940 à 1995 » (Histoire des sciences médicales, tomme XXX, n°2, 1996). En effet, en raison de la disposition des organes génitaux féminins, il lui fallut trouver le moyen d’accéder aux trompes et aux ovaires qui se situent derrière l’utérus. Pour cela, il tenta de recourir à la culdoscopie, c’est-à-dire de passer par le cul-de-sac postérieur du vagin. Mais Palmer n’était pas satisfait des résultats obtenus par cette voie (qui fut néanmoins la plus utilisée dans les années 60 et 70). Persuadé que la voie abdominale restait la meilleure, il eut alors l’idée d’utiliser « une sonde destinée aux explorations radiologiques de l’utérus [qui] lui permit de relever l’organe vers l’avant, libérant l’ensemble trompe-ovaire qui devint ainsi spectaculairement « lisible » au travers d’une simple optique transombilicale ».
Néanmoins, les habitudes ont la vie dure et, en cas d’infertilité, la laparotomie demeura pendant très longtemps la technique de première intention comme le relate le Pr Hervé Fernandez : « Auparavant, en cas d’infertilité, on n’opérait pas. Et les rares fois où l’on procédait à une intervention chirurgicale, le taux de morbidité était extrêmement élevé. » Cependant, Palmer continua dans les années 50 et 60 à améliorer sa technique : électrocoagulation des trompes par voie endoscopique en 1958, prélèvement d’ovocytes à ventre fermé en 1961 etc.
Il fallut attendre les années 70 et les progrès réalisés sur les fibres optiques pour que de plus en plus de chirurgiens gynécologues se convertissent à la cœliochirurgie. Ainsi, en 1972, fut traitée la première grossesse extra-utérine sans laparotomie.
Le tournant des années 90
« On assista donc dans les années 90 au développement de la cœliochirurgie qui permit de réduire de manière significative l’invasivité et les risques », relate le Pr Michael Grynberg, chef du service de Médecine de la reproduction et préservation de la fertilité à l’hôpital Jean Verdier à Bondy et spécialiste en reproduction humaine. Dans les années 90, une nouvelle innovation vint bouleverser le paysage du traitement de l’infertilité avec la mise au point de nouvelles techniques et de nouveaux dispositifs. Ainsi, en 1997, Gordts décrivit pour la première fois la technique. La même année, il mit au point la fertiloscopie avec Antoine Watrelot qui la décrivit ainsi dans un article intitulé « La fertiloscopie : technique et indications » (La lettre du gynécologue, mai 2000) : « En 1997, nous avons, avec Gordts, décrit la fertiloscopie comme l’association, dans le même temps opératoire, d’une hydropelviscopie transvaginale, d’une épreuve de perméabilité tubaire, d’une salpingoscopie (à laquelle, plus récemment, nous avons adjoint une microsalpingoscopie) et enfin d’une hystéroscopie. » Ainsi la fertiloscopie recourt-elle à une instrumentation permettant de réaliser ces divers examens. A l’origine exclusivement diagnostique, elle permit par la suite également de traiter l’infertilité. Fiable, peu invasive, entraînant peu de complications, cette technique révolutionna la chirurgie de la fertilité. Mais la démocratisation, dans les années 2000, des fécondations in vitro en cas d’infertilité fit grand tort à la fertiloscopie et aux techniques qui lui sont associées comme le souligne le Pr Fernandez : « Autrefois, on procédait à une fécondation in vitro principalement en cas de pathologie tubaire, c’est-à-dire touchant les trompes. Puis son recours s’est étendu à de nombreuses indications. » Et ce, « y compris lorsqu’aucune cause ne permet d’expliquer l’infertilité », explique le Pr Grynberg. Les taux de succès de la FIV, qui ne dépassent pas les 40 %, montrent l’importance de laisser une place à d’autres alternatives thérapeutiques, notamment à la chirurgie ». Aujourd’hui, « on assiste à un retour de la place de la chirurgie dans le traitement de l’infertilité, constate le Pr Fernandez. En matière d’infertilité, les progrès réalisés et l’arsenal dont nous disposons désormais permettent de répondre aux besoins actuels parmi lesquels l’âge moyen d’avoir des enfants qui est plus tardif ou encore les terribles conséquences du tabac sur le mécanisme de ciliature et qui entretient les pathologies tubaires. »
200 000 FIV
Le premier « bébé éprouvette », c’est-à-dire conçu par fécondation in vitro, est né en 1978 en Grande-Bretagne et s’appelle Louise Brown. En France, c’est en 1982 que naquit Amandine avec la même technique. Ainsi, en trente ans ce sont plus de 200 000 enfants qui ont été conçus par fécondation in vitro en France, selon l’Ined*.
En 2015, en France, plus de 25 000 enfants sont nés par procréation médicale assistée soit 3,1 % des naissances.**
* Source : « 200 000 enfants conçus par fécondation in vitro en France depuis 30 ans », sous la direction d’Élise de La Rochebrochard, Population et Sociétés n° 451, décembre 2008.
** Selon les chiffres de l’Agence de biomédecine.
6. Dispositif intra-utérin
Au service de la maîtrise de la fécondité
Les femmes disposent d’une vaste palette de moyens contraceptifs leur donnant la possibilité de choisir le moyen le plus adapté à leur situation, à leurs besoins et à leurs envies. Parmi ces options figurent les dispositifs et systèmes intra-utérins, aujourd’hui largement répandus.
Le Dispositif intra-utérin (DIU) permet, comme les autres moyens contraceptifs, de contrôler la fertilité. Il relève des dispositifs dits LARC (Long Acting Reversible Contraception) par opposition aux contraceptifs à action rapide (pilules, patchs, anneaux), à la contraception dite définitive (stérilisation) et au préservatif. D’un point de vue mécanique, sa présence dans la cavité utérine empêche la fécondation. Il est actif dès sa pose. Après son retrait, le retour de la fécondité est immédiat. Aucun moyen de contraception n’est fiable à 100 %. Il existe donc quelques rares cas d’échec pour le DIU, « moins de 1 % » précise le Dr David Elia, gynécologue. Ceux-ci sont principalement dus au déplacement ou à l’expulsion du dispositif intra-utérin.
Le DIU est un petit dispositif en polyéthylène et en forme de T. Il est placé par un médecin ou une sage-femme dans la cavité utérine en général pour une durée de 5 ans. Des fils de nylon permettent de vérifier sa présence et de le retirer. Il existe aujourd’hui deux sortes de DIU : ceux en cuivre et ceux hormonaux. Concernant la première catégorie, le cuivre a une action mécanique : « Il crée une inflammation de l’endomètre qui empêche l’œuf de s’implanter dans l’utérus », précise le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). Dans certains rares cas, la femme peut avoir des règles plus abondantes et plus longues les premiers mois qui suivent la pose du dispositif. Quant aux seconds dispositifs, « le cuivre est remplacé par un réservoir contenant de la progestérone libérée très progressivement », poursuit le Collège. Et d’ajouter : « Le stérilet hormonal rend la glaire cervicale opaque, gênant la progression des spermatozoïdes. Il crée une atrophie de l’endomètre empêchant une éventuelle nidation ». A noter que chaque femme peut réagir différemment à la pose de ce dispositif contenant une hormone (prise de poids, acné, abondance des règles etc.).
« Les êtres humains ont toujours essayé de contrôler la fécondité, notamment en plaçant dans le vagin ou même l’utérus toutes sortes de préparation ou d’objet, souvent plus barbares les uns que les autres », explique le Dr Elia. En matière de contraceptifs vaginaux en effet, la littérature fait état d’une incroyable imagination, et ce depuis l’Antiquité, tant concernant le type d’ingestion ou d’application (huiles, onguents, pommades, infusions…) que sur les substances qui les constituent (miel, mandragore, épices comme le safran, pulpe de figue ou de grenade, excréments, douche vaginale à l’eau froide après les rapports, plantes médicinales etc.). Tout ou presque fut expérimenté, non sans entraîner parfois de dangereuses complications pour les femmes mais surtout une grande inefficacité contraceptive ! Concernant plus spécifiquement le principe sur lequel repose les dispositifs intra-utérins, il apparait que, dès l’Antiquité, les chameliers plaçaient des petites pierres dans l’utérus de leurs chamelles afin d’éviter qu’elles ne soient gestantes durant les longues routes qu’ils parcouraient. Mais c’est au médecin grec Soranos d’Ephèse (IIe siècle après Jésus-Christ), considéré comme le père de l’obstétrique et de la gynécologie, que l’on doit « l’exposé médical le plus rationnel de l’Antiquité en matière de prévention des naissances », selon Etienne Van de Walle. Méfiant envers les superstitions et autres procédés chimiques violents, il « mentionne aussi une série de produits astringents introduits par suppositoires ou par voie de pessaire, dont la fonction est de resserrer le col de la matrice pour empêcher le sperme d’entrer » (« Comment prévenait-on les naissances avant la contraception moderne », Etienne Van de Walle, Population et sociétés n°418, Ined, 2005). Toutefois, l’emploi de la contraception restait, à cette époque, quelque chose d’extrêmement encadré et préconisé dans de très rares cas (lorsque l’épouse était trop jeune ou que la grossesse s’avérait dangereuse). Avec l’avènement de l’ère chrétienne, la contraception tout comme l’avortement furent purement et simplement interdits et condamnés. Néanmoins, en la matière, diverses croyances (foie de chat, boisson à base d’eau dans laquelle un forgeron a fait refroidir ses outils…) perdurèrent durant le Moyen-Âge et les Temps modernes.
Des expérimentations à risque
Il fallut donc attendre le XIXe siècle pour voir la situation évoluer. En effet, dès l’aube de ce siècle, la question du contrôle des naissances devint centrale, notamment avec la publication, par Thomas Malthus, d’un essai dans lequel il avança que la population croissait de manière exponentielle alors même que les ressources croissaient, elles, beaucoup plus lentement. Il préconisa donc un contrôle de la croissance démographique et des naissances. Il ne fallait cependant pas voir là un encouragement au développement des moyens contraceptifs, bien au contraire : dans un monde encore très conservateur, l’économiste britannique prône un contrôle moral, c’est-à-dire ni plus ni moins que l’abstinence. On vit apparaître au cours de ce siècle des dispositifs vaginaux tels que la cape cervicale qui se glisse dans le vagin au contact du col de l’utérus pour empêcher le passage des spermatozoïdes (1830), le pessaire et le diaphragme (1882). Quant aux dispositifs intra-utérins, ils rivalisaient d’originalité au niveau des matériaux (bois, ivoire, ébène, étain, argent, or ou encore platine, parfois même sertis de diamants) et étaient loin d’être sans risque : ils « entraînaient des complications hémorragiques infectieuses et parfois la mort des utilisatrices » et « furent rapidement condamnés par le corps médical », explique Gwénaëlle Cavaro-Aschehoug dans sa thèse intitulée « Dispositifs intra-utérins : historique et analyse de leurs représentations par la réalisation d’un focus group de médecins généralistes » (2007). Les recherches et expérimentations se poursuivirent durant la première moitié du XXe siècle, notamment sur les matériaux. Ainsi, en 1909, fut décrit, pour la première fois, un dispositif intra-utérin à usage contraceptif par un médecin allemand, Richard Richter : « Il s’agit d’un anneau fait de deux fils en crin de Florence enroulés selon une combinaison particulière, dont les extrémités libres étaient recouvertes d’un film pour protéger l’endomètre, détaille Gwénaëlle Cavaro-Aschehoug. Ces fils étaient unis par un filament fin en bronze pour permettre le diagnostic des expulsions et faciliter le retrait du système ». Toutefois, le dispositif de Richter n’eut à l’époque que peu d’échos. Dans les années 20, « de nombreux médecins s’essayèrent de nouveau à l’élaboration de dispositifs intra-utérins », raconte le Dr Elia. Ils recoururent à divers matériaux dont l’or et l’argent. Ainsi, le gynécologue allemand Ernest Gräfenberg mit au point un anneau tressé fait d’un alliage de zinc, de nickel et de cuivre notamment. Mais, tant physiologiquement (infections) que sociologiquement (les consciences étant encore réfractaires au concept même de planning familial), son anneau fut relativement mal accueilli en Europe comme aux Etats-Unis où il émigra pour fuir l’Allemagne nazie.
La révolution du plastique
Il fallut attendre le début des années 60 pour que soit amorcé un tournant décisif dans l’histoire des DIU : « L’arrivée de la boucle de Lippes et de la spirale de Marfulies révolutionna le paysage des dispositifs contraceptifs, raconte le Dr Elia. Jack Lippes fut en effet le premier à utiliser le polyéthylène, un plastique biologiquement inerte et bien toléré. Cela augmenta de façon significative l’efficacité du dispositif. Toutefois, il existait de nombreuses formes différentes et les dispositifs restaient de taille importante, ce qui les rendait souvent douloureux. » Ce fut donc au cours de la décennie suivante que furent apportées de nouvelles améliorations dans un contexte de révolution sexuelle qui favorisa le développement et la diffusion des contraceptifs en général et des DIU ; et ce, en particulier sous l’impulsion du Docteur Pierre Simon, père de la contraception moderne en France et cofondateur du planning familial. « Dans les années 70, un filament de cuivre fut ajouté au dispositif en polyéthylène, poursuit le spécialiste. Posé pour deux ans, le dispositif opère une action contraceptive spécifique, est spermicide et vient ainsi ajouter son propre effet à celui du plastique. Le stérilet au cuivre a ainsi trois actions supposées : il rend la muqueuse utérine hostile à la nidation de l’œuf, il augmente sans doute la progression de l’œuf dans les trompes et il est spermicide. » Un travail important sur la taille des dispositifs fut également mené, à cette époque puis dans les années 80, couplé à une augmentation de la charge en cuivre (actuellement 380 mm2), ce qui permit de laisser les stérilets en place sans les changer pendant 5 à 10 ans. Désormais plus petits, ils sont non seulement plus faciles à poser mais présentent également une meilleure tolérance. A noter que ces années marquèrent également le recul et même la quasi-disparition du diaphragme, aujourd’hui, pour ainsi dire, tombé en désuétude en France.
L’arrivée des hormones progestatives
Au début des années 90 apparurent les implants contraceptifs sous-cutanés en silicone. Il fallut néanmoins attendre la première moitié des années 2000 pour qu’ils arrivent en France. C’est à cette époque que fut d’ailleurs apportée une innovation significative aux stérilets : l’adjonction d’une hormone progestative dans le DIU, le rendant ainsi non seulement contraceptif mais permettant également de limiter les saignements lors des règles. Dans la lignée, apparurent, en 2004, l’implant et l’anneau vaginal contraceptif œstroprogestatif (« pilule par le vagin »). Cet anneau souple, transparent et incolore bloque en effet l’ovulation. La femme le pose elle-même dans son vagin pour une durée de trois semaines. Après une semaine sans anneau, il convient d’en poser un nouveau et ainsi de suite. Néanmoins, ces méthodes de contraception restent encore marginales puisqu’en 2013 seules 3,6 % des femmes recouraient à un implant, à un patch (« pilule par la peau ») ou à un anneau. L’année 2004 vit également la publication de recommandations par la Haute autorité de santé (HAS) selon lesquelles il n’y a pas de contre-indication à poser un DIU à une femme nullipare, c’est-à-dire n’ayant pas eu d’enfant. Malgré cela, les croyances persistent puisque en 2010, 54 % des femmes considéraient encore que cette méthode n’était pas indiquée pour une femme n’ayant pas eu d’enfant. Une proportion qui s’élevait à 69 % chez les gynécologues et 84 % chez les médecins généralistes, selon l’enquête Fecond 2010 de l’Ined. Quant à l’avenir, « il y a peu de chance qu’un concept révolutionnaire vienne bouleverser le paysage des DIU dans un avenir proche, prévoit le Dr Elia. On pourra voir des améliorations, notamment avec des dispositifs intra-utérins encore mieux tolérés et encore plus efficaces mais on peut considérer que nous avons atteint aujourd’hui un certain seuil. Et notamment celui, pour chaque femme, de pouvoir choisir, en accord avec son médecin, la contraception qui lui convient le mieux, à n’importe quelle étape de sa vie. »
Le saviez-vous ?
Les hommes aussi s’intéressent à la contraception ! En France, ils ont même leur association dédiée. Créée en 1979 dans le sillage des groupes féministes, l’Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine (ARDECOM) se veut à la fois un espace de parole et de réflexion sur la contraception masculine et sur les inégalités entre les femmes et les hommes en la matière.
À savoir
Le DIU est plus souvent connu sous le nom de stérilet. Cette appellation est aujourd’hui impropre comme le souligne le Dr David Elia : « le terme a été inventé dans les années 60 par le Dr Pierre Simon, pionnier de la contraception moderne. Aujourd’hui, on lui préfère le terme de dispositif intra-utérin car il ne rend pas stérile. »
A l’époque, Pierre Simon craignait que l’appellation de DIU ne rende le dispositif impopulaire et ne conduise à son échec.
7. Instruments d’extraction
Sauver la mère et l’enfant
Longtemps considéré comme un acte exclusivement naturel dont l’issue pouvait souvent être fatale, l’accouchement a bénéficié d’innovations successives qui ont permis de le rendre toujours plus sûr pour la mère comme pour son enfant.
Lors d’un accouchement par voie basse, certaines difficultés peuvent survenir et obliger l’équipe médicale à procéder à une extraction instrumentale afin d’aider l’expulsion du bébé à l’aide de forceps, de ventouses ou de spatules. « Les principales indications sont les anomalies du rythme cardiaque fœtal (…), précise le Collège national des gynécologues et obstétriciens français dans ses « Recommandations pour la pratique clinique ». Il est recommandé d’envisager le recours à une extraction instrumentale à partir de 30 minutes d’efforts expulsifs avec un RCF (Rythme cardiaque fœtal, note de la rédaction) normal, dans la mesure où l’intensité des efforts expulsifs a été jugée suffisante sans progression du mobile fœtal. » A noter qu’en cas d’échec de l’extraction instrumentale, il peut être nécessaire de procéder à une césarienne rapidement.
Divers instruments peuvent intervenir pour permettre de modifier la position du bébé, de l’orienter ou de l’extraire :
- Le forceps : cet instrument d’extraction sert à guider le mobile fœtal. Sorte de grosse pince, il existe des forceps à branches croisées ou à branches convergentes. Bien placé de chaque côté de la tête du bébé, ce dispositif présente très peu de risques pour lui.
- Les ventouses : ces instruments ont une fonction de flexion, de traction et de rotation de la tête du bébé. Posées sur le crâne du bébé, leur but est d’orienter la tête si elle n’est pas en bonne position afin de lui faire occuper le moins de place possible et de faciliter la sortie au moyen d’une poignée maniée par l’obstétricien. Si elles permettent de protéger le périnée, elles peuvent toutefois provoquer une petite bosse ou un petit hématome (sans gravité ni conséquence) sur le crâne de l’enfant.
- Les spatules : ce sont des instruments de propulsion et d’orientation. Composées de deux cuillères dentelées en métal, elles peuvent donner l’impression de ressembler au forceps mais leur maniement et leur fonction diffèrent beaucoup car elles ne sont pas reliées entre elles. Elles sont considérées comme le prolongement des mains du médecin et aident le bébé à avancer dans le vagin.
L’histoire des dispositifs d’obstétrique va de pair avec celle de la conception même de la naissance par les hommes. Ainsi, durant des millénaires, l’accouchement relevait de l’intime et de la sphère privée. Il était perçu comme l’apanage exclusif des femmes. « L’histoire de la naissance a longtemps été une histoire immobile : pendant des millénaires, chaque femme accouchait à la maison, dans un espace familier, entourée de compagnes plus ou moins expertes », relate la Société française de la naissance. Ainsi, dans la Grèce antique, des sages-femmes pratiquaient la maïeutique ou l’art de l’accouchement. A Rome, c’était la prérogative des obstetrix qui donnèrent leur nom à la discipline. Dans l’Antiquité comme au Moyen-Âge, l’accouchement – une affaire exclusivement féminine dont on se transmettait les secrets oralement – était redouté et l’instrumentation (lit, linges, feu, eau chaude, fil voire ustensiles de cuisine) très archaïque : la mortalité et les mutilations restaient alors très élevées, comme le relate le « Traité de l’art des accouchements » : « L’idée d’extraire le fœtus par les voies naturelles à l’aide de pinces spéciales est fort ancienne mais pendant très longtemps, pareille opération resta incompatible avec la survie de l’enfant, que l’on considérait comme inévitablement voué à la mort quand on devait employer des instruments métalliques. » Il n’était pas rare, alors, qu’en cas de mort du fœtus, soit appelé un barbier qui procédait à l’embryotomie, la priorité étant donnée à la vie maternelle. Ce furent d’ailleurs deux frères chirurgiens, les Chamberlen, qui mirent au point le premier forceps au XVIe siècle. L’objectif de cet instrument, qui avait la forme d’une pince dont les mors étaient courbés de façon à s’adapter à la tête du fœtus, était de faire diminuer aussi bien la mortalité maternelle que celle des nouveau-nés afin d’extraire l’enfant vivant. L’invention resta néanmoins confidentielle durant près d’un siècle, notamment en raison de la méfiance suscitée par l’objet.
La révolution du forceps
Au XVIIe siècle, en France, l’obstétrique commença à être reconnue comme une science avec la parution des premiers traités fondateurs et même d’un lieu de formation des sages-femmes à l’Hôtel Dieu, à Paris. Celles-ci restaient encore les actrices principales de l’accouchement. Puis, durant la deuxième moitié du siècle et surtout au XVIIIe siècle, l’on vit des chirurgiens commencer à prendre part à l’accouchement dans certaines situations complexes. Ce fut d’abord le cas dans la noblesse puis dans la bourgeoisie avant de s’étendre au fil des siècles. Divers chirurgiens européens cherchèrent à améliorer l’objet. Parmi les plus illustres, on peut citer Jan Palfyn (« Les mains de fer » en 1720), André Levret (qui ajouta, en 1747, à la courbure céphalique du forceps de Chamberlen la courbure pelvienne) ou encore William Smellie (1751) qui travailla également sur la courbure. Les apports de ces deux derniers praticiens marquèrent une véritable révolution puisqu’ils permirent la naissance d’enfants qui seraient autrefois restés coincés dans le bassin. Ce fut dès lors un tournant dans l’histoire de l’accouchement, celui-ci n’étant plus conçu comme un acte purement naturel mais comme relevant de « l’art de l’accoucheur ». L’arrivée des dispositifs médicaux fut le premier pas vers la médicalisation de la naissance. Autre fait significatif de ce changement de perception : l’usage des dispositifs était uniquement dévolu aux obstétriciens, les sages-femmes n’en ayant pas le droit. Bien que le forceps représentât un réel progrès, la mortalité et les drames restaient élevés, notamment parce que certains accoucheurs abusèrent de ces instruments. Dans la lignée de la reconnaissance de l’obstétrique amorcée au siècle précédent, apparurent, au XVIIIe siècle, les premiers centres d’accouchements (Strasbourg, Londres) et la première maternité en Allemagne. En France, la formation des sages-femmes connut un essor à partir du milieu du siècle, notamment sous l’impulsion d’Angélique du Coudray, sage-femme qui prodiguait un enseignement itinérant des techniques d’accouchement.
Une médicalisation toujours plus grande
Les XIXe et XXe siècles furent marqués par la médicalisation toujours plus grande de l’accouchement. Ainsi, au XIXe siècle, l’anesthésie (chloroforme, opium, morphine, éther) fut introduite dans les salles d’accouchement. Si cette technique se développa particulièrement en Angleterre et aux Etats-Unis, des réticences persistèrent en France, en particulier en raison des effets secondaires (inertie utérine, hémorragies à la délivrance). On considérait alors que cela compliquait l’accouchement (voir le livret consacré à l’anesthésie réanimation). En 1849 fut mise au point une ventouse, « l’air tractor », par J. Y. Simpson. Toutefois, son instrument, très imparfait, fut vite abandonné. Dans les décennies qui suivirent, divers inventeurs s’essayèrent à mettre au point des instruments utilisant le vide mais sans grand succès. Parallèlement, durant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, le forceps continua d’évoluer. Il faut souligner ici l’apport de Stéphane Etienne Tarnier qui améliora le forceps croisé en lui adjoignant un système permettant d’exercer les tractions sur la tête de l’enfant. À sa suite, Demelin, Pajot et Suzor travaillèrent sur la taille du forceps, sa forme, la courbure des branches, leur articulation (croisées ou non) ou encore leur force de traction. Au début du XXe siècle, les hôpitaux continuaient de faire peur en raison des épidémies de fièvre puerpérale et ce, malgré l’apparition de l’asepsie (voir encadré). La grande majorité des naissances avaient encore lieu à la maison. Puis, dans l’Entre-deux-guerres, les méthodes se sophistiquèrent progressivement et la naissance médicalisée se développa en France, surtout dans les grandes villes. Les années 50 virent l’apparition de la ventouse moderne, la ventouse de Malmström, ainsi que de celle des spatules de Thierry composées de deux leviers indépendants.
Ces nouvelles innovations participèrent à rendre l’hôpital encore plus rassurant pour les patientes, celui-ci étant devenu plus moderne et plurifonctionnel. Ainsi, en 1952, 53 % des accouchements avaient lieu à l’hôpital. Dix ans plus tard, le taux était de 85 %. Les années 70, 80 et 90 furent, elles aussi, marquées par des innovations qui révolutionnèrent littéralement le suivi de la grossesse ainsi que l’accouchement : échographie, monitoring, péridurale, amnioscopie… Ce tournant marque la médicalisation totale de la naissance, celle-ci ayant également bénéficié des énormes progrès réalisés dans d’autres spécialités médicales : anesthésie-réanimation (ventilation, oxygénothérapie), imagerie, monitorage et surveillance des paramètres, perfusion… Avec, à la clé, un gain en termes de sécurité et de perte de douleur. Ainsi, selon l’OMS, la mortalité maternelle a pratiquement diminué de 44 % à l’échelle mondiale entre 1990 et 2015. Un progrès qui doit beaucoup
aux dispositifs et aux techniques obstétriques innovants.
À savoir
Connue dès l’Antiquité, la césarienne ne fut néanmoins pratiquée durant des siècles que dans les cas où la mère était morte afin de tenter de sauver l’enfant. S’il est difficile de savoir avec certitude qui pratiqua avec succès la première césarienne sur une femme vivante, on situe néanmoins les premiers cas rapportés au XVIe siècle. La césarienne connut ensuite de véritables progrès au XIXe siècle, en raison notamment des nouvelles techniques d’incision et de suture mais aussi grâce au développement de l’asepsie dans la deuxième moitié du siècle sous l’impulsion de Louis Pasteur, des antibiotiques et de l’anesthésie-réanimation au XXe siècle.
8. Déclenchement et maturation cervicale
Un dispositif au plus près du travail naturel
Longtemps, il n’y eut pas d’alternative à la chirurgie pour intervenir en cas de grossesse prolongée. Il existe désormais des dispositifs médicaux capables de permettre une maturation cervicale progressive à l’action proche du travail naturel.
En cas de grossesse prolongée, lorsque le terme est dépassé mais que le travail ne débute pas spontanément sous l’effet de contraction, on peut être amené à devoir intervenir afin de déclencher le travail. Le choix de la méthode de déclenchement ainsi que son succès dépendent de l’état du col de l’utérus, celui-ci étant évalué selon « le score de Bishop qui repose sur divers critères (consistance, longueur, dilatation, position du bébé…) », explique le Professeur Philippe Deruelle, Secrétaire général du Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF) et responsable du service Obstétrique du CHRU de Lille. Si le col est défavorable (trop long, encore fermé, trop ferme), il faut en faciliter la maturation afin que le travail puisse être déclenché par la suite. Cela peut être fait au moyen d’un dispositif médical qui se présente sous la forme d’un double ballonnet et va provoquer artificiellement le début de travail. » Outre une grossesse prolongée avec dépassement du terme (qui en est l’indication principale), une maturation cervicale mécanique via un dispositif médical peut être également indiquée en cas d’hypertension artérielle, de retard de croissance, de diabète etc. Enfin, lorsque les conditions de maturation du col sont favorables, le travail peut être directement déclenché.
Le double ballonnet est un dispositif mécanique – par opposition aux méthodes pharmacologiques – utilisé dans le cadre du déclenchement du travail, également appelé induction. En silicone, il est facile à poser, à retirer et agit directement sur le col. Il consiste à introduire doucement dans le col de l’utérus une sorte de cathéter qui ressemble à une sonde urinaire et au bout duquel se trouve le premier ballonnet que l’on gonfle en partie à l’intérieur. Puis, on tire légèrement dessus afin de gonfler le second ballonnet à l’extérieur. A noter que les ballonnets sont gonflés avec du sérum physiologique. Ainsi positionné, le dispositif favorise la dilatation progressive du col en exerçant une pression constante et modérée du col à l’orifice interne (poche des eaux) et à l’orifice externe (vagin). Au bout de quelques heures, soit le col est suffisamment dilaté et le double ballonnet tombe, soit il faut le retirer au bout de 12 heures maximum. Le double ballonnet augmente le score de Bishop de 3 à 4 points et peut aller jusqu’à provoquer des contractions car il décolle les membranes et produit les prostaglandines, les substances responsables des contractions.
On trouve des traces de techniques de dilatation du col très loin dans l’Histoire. Par exemple, pendant longtemps, « on recourrait à la chirurgie pour provoquer la dilatation du col, relate le Pr Deruelle. On utilisait des bougies, c’est-à-dire des tubes métalliques de taille croissante. La dilatation est également possible par des laminaires qui reposent sur un système hydrométrique, ce qui signifie qu’ils grossissent au contact des sécrétions. » Mais ces méthodes étaient très risquées car elles entraînaient souvent des infections et étaient en outre très douloureuses car la dilatation n’était pas progressive mais au contraire brutale. Ainsi, « on a surtout eu recours à cette méthode dans les années 70 avant que la méthode médicamenteuse ne fasse son apparition, constate le Pr Deruelle. Puis, dans les années 80 et 90, J. Atad mit au point un double ballonnet comprimant le col. » Mais il fallut donc attendre le milieu des années 2000 pour que le dispositif, désormais en silicone, connaisse un réel développement.
Un large panel d’outils pour la maturation cervicale
Aujourd’hui arrivé à maturité, ce dispositif a vraiment participé au renouveau des méthodes mécaniques tout en limitant les infections et le caractère agressif d’antan. En outre, il existe aujourd’hui d’autres dispositifs qui ont une action équivalente au ballonnet et qui agissent sur les prostaglandines. Ils se présentent sous la forme de gel ou de tampon. Néanmoins, « selon les diverses études qui ont été menées sur les méthodes de déclenchement, il semble que la tolérance fœtale est un peu moins bonne avec ces dispositifs qu’avec le double ballonnet, nuance le Pr Deruelle. Ce dernier est plus progressif, se rapproche du travail naturel et est bien toléré par les patientes en termes de douleur. Il se montre aujourd’hui particulièrement efficace dans la mesure où il permet un accouchement par voie naturelle et donc diminue le risque de césarienne. Aujourd’hui, ce dispositif élargit encore le panel d’outils dont on peut disposer en fonction de l’état et la situation de la patiente. Le fait de disposer de techniques plus larges, médicamenteuses et mécaniques pour l’induction du travail permet de s’adapter toujours mieux aux besoins et aux envies des patientes, de personnaliser les prises en charge et de proposer le déclenchement le plus approprié ».
9. Tamponnement de l’hémorragie du post-partum
Faire cesser les hémorragies
Longtemps première cause des décès maternels, l’hémorragie du post-partum a connu, ces dernières années, un progrès révolutionnaire grâce aux dispositifs de tamponnement intra-utérin modernes.
Après la délivrance, peut survenir ce que l’on appelle une Hémorragie du post-partum (HPP). Celle-ci se définit par une perte sanguine supérieure ou égale à 500 ml dans les 24 heures suivant un accouchement par voie basse ou par césarienne. Les raisons peuvent être diverses : perte de tonicité de l’utérus à cause d’une rétention de matériel (caillots ou bouts de placenta), travail prolongé ou inefficace d’une grande multiparité, fibrome, distension utérine au cours de la grossesse, antécédents d’HPP. Il est alors donc nécessaire de contrôler le saignement. C’est le rôle du tamponnement par ballon : juguler l’hémorragie du segment inférieur, diminuer les complications, quantifier les pertes sanguines et les récolter. La quantification des pertes sanguines peut également s’avérer d’une précieuse utilité pour les équipes d’anesthésie-réanimation en cas d’intervention. Cependant, toutes les maternités ne disposent pas de plateau technique pour réaliser une embolisation en cas de besoin. Il arrive donc que certaines patientes, suite à une HPP, doivent être transférées. La pose d’un ballon rend ce transfert moins dangereux, augmente les chances de préserver l’utérus et diminue les risques de devoir procéder à une hystérectomie.
Une fois déclarée et constatée, la prise en charge de l’hémorragie du post-partum répond à un algorithme précis d’étapes à suivre. Le retard diagnostique d’HPP augmente les risques de forme sévère. Il faut, dans un premier temps, évaluer l’hémorragie et surveiller les paramètres de la patiente (signes vitaux, pâleur, pression artérielle, production d’urine, tonus utérin, perte sanguine active et totale, fonction pulmonaire, taux d’hématocrite et état général). Il est nécessaire d’évaluer le volume des pertes sanguines car celles-ci sont souvent sous-estimées. A l’issue d’une procédure bien précise (réalisation d’actes notamment thérapeutiques définis), il peut être nécessaire de procéder à un moyen mécanique de tamponnement. Ce procédé est endo-utérin, non invasif et conservateur. Il est appliqué sous contrôle échographique. « Le dispositif de tamponnement est constitué d’un ballon adapté à la forme et à la taille de l’utérus », explique l’un des pionniers dans l’utilisation de ce dispositif en France, le Pr Jacky Nizard du service de Gynécologie-obstétrique à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris). Le dispositif comporte également une tubulure, une valve anti-retour pour une instillation rapide du ballon lors de sa mise en place et une grosse seringue. Une extrémité du conduit de la tubulure dotée d’un robinet permet de gonfler le ballon avec du sérum physiologique ou de l’eau stérile, notamment. L’autre sert à drainer le sang de l’utérus. Le ballon est relativement volumineux puisqu’il a une capacité pouvant aller jusqu’à 500 ml. En silicone, il est facile à manier et n’adhère pas. Il arrive que, pour certains cas graves, le tamponnement mécanique ne fonctionne pas. Il convient alors de recourir à une embolisation (obstruction d’une artère), à une chirurgie des ligatures, voire à une hystérectomie totale.
« On recourt depuis longtemps au principe de tamponnement endo-utérin dans la prise en charge de l’hémorragie du post-partum, explique le Pr Nizard. On a utilisé tout ce que l’on pouvait avoir sous la main : gaze, champ opératoire ou même le poing », poursuit le spécialiste. Néanmoins, la technique du tamponnement intra-utérin fut abandonnée dans les années 50 de crainte qu’elle ne masque des traumatismes et des saignements continus et qu’elle provoque des infections. Il fallut attendre les années 80 pour que cette technique connaisse un regain d’intérêt. Ainsi, dans les années 90, « diverses sondes habituellement réservées à d’autres usages ont été employées afin de réaliser une compression intra-utérine : sondes Foley qui sont des sondes urinaires, sondes de Sengstaken-Blakemore utilisées pour les hémorragies digestives hautes... », relate le Pr Nizard. Néanmoins, jusque dans les années 90, l’hémorragie de la délivrance représentait 30 % des causes de décès maternels et elle est longtemps restée la première cause de décès maternels dans les pays développés. A noter que le tamponnement intra-utérin restait une technique à laquelle on recourait rarement, en urgence et en dernier recours lui étaient préférés. En cas d’hémorragie de la délivrance, des moyens très invasifs tels que l’embolisation artérielle. Or, pour cela, il y a besoin d’un plateau technique, ce dont toutes les maternités ne sont pas dotées. Cela nécessite donc de transférer certaines patientes au risque de provoquer chez elles de graves complications. Ainsi, les chiffres se sont améliorés quand la prise en charge globale (prévention et traitement) de l’HPP s’est standardisée.
Un dispositif spécifiquement dédié
Il fallut attendre la fin des années 90 et le début des années 2000 pour que le Dr Younes Bakri mette au point un dispositif spécifiquement dédié au tamponnement intra-utérin et que celui-ci soit commercialisé. Parfaitement adapté à la morphologie et à la taille de l’utérus, ce ballon en silicone a été très bien accueilli, particulièrement en France : « Ce dispositif a permis de remplacer les moyens extrêmement invasifs jusqu’ici plébiscités, se souvient le Pr Nizard. Parce qu’il est facile à utiliser et peut être posé dans n’importe quelle situation, même sur un brancard, il est littéralement révolutionnaire. Ne nécessitant pas de plateau technique spécialisé, ce type de dispositif est même devenu un recours de deuxième ligne, juste derrière le recours médicamenteux. » Dans les années suivantes, divers ballons furent mis au point. Mais, s’ils diffèrent par la taille, ils fonctionnent tous sur le même principe et ont permis de réduire de manière significative les complications du post-partum : « Pour preuve, aujourd’hui, 90 % des HPP sont traitées avec succès grâce au recours médicamenteux. Et 90 % des 10 % restant le sont grâce au dispositif de tamponnement intra-utérin », estime le Pr Nizard. Ainsi, depuis la publication d’une recommandation officielle en 2014, il est préconisé, en France, de poser un dispositif de tamponnement intra-utérin à toutes les patientes qui doivent être transférées, ce qui arrête les saignements et sécurise les transferts. Cela a considérablement amélioré la prise en charge globale des patientes. A noter d’ailleurs qu’aujourd’hui, une très grande majorité des patientes qui
doivent être transférées dans un centre disposant d’un plateau technique et qui sont pourvues d’un tel dispositif le sont essentiellement dans une optique de surveillance plus que d’intervention. Néanmoins, si le dispositif lui-même semble être arrivé à maturité, il reste d’une part à en harmoniser les protocoles de pose en France et, d’autre part, à en favoriser la diffusion à l’international, l’hémorragie du post-partum restant une des principales causes de décès maternels dans certaines régions du Monde.
10. Gels lubrifiants
Des dispositifs médicaux depuis 1993
L’enjeu de l’innovation, dans ce domaine, a été de développer des produits compatibles avec les muqueuses vaginales, les hydratants et améliorant leur état, sans négliger le confort d’utilisation.
Les gels ont un effet de lubrification lors des rapports sexuels et de lutte contre la sécheresse intime. La sécheresse touche les femmes de tous âges. Elle est favorisée par la prise de certains médicaments (antihistaminiques, antidépresseurs, antiacnéiques, pilules microdosées), les douches vaginales, l’usage de savons agressifs, le port prolongé de tampon, le tabagisme, le stress ou encore les variations hormonales (pendant ou après une grossesse, au cours du cycle menstruel, à la ménopause).
Les gels lubrifiants sont appliqués au niveau du vagin. Ils sont compatibles avec les préservatifs en latex et en polyuréthane masculins comme féminins (diaphragme) et sont neutres biologiquement pour ne pas provoquer de maladie, de réaction allergique ou de brûlure. Ce traitement local de la sécheresse intime, qui évite tout traitement hormonal ou médicamenteux, assure un effet rémanent sans affecter l’équilibre hormonal des femmes.
Les premiers gels, à la fin des années 80 et au début des années 90, ont remplacé l’usage de vaseline et d’huile. Lubrifiants, ils étaient essentiellement conçus pour le confort immédiat lors des rapports sexuels sans être nécessairement pensés pour une cible féminine. Souvent à base d’eau, ils séchaient assez vite et n’avaient pas d’action rémanente. L’indication « plaisir » prévalait tandis que les indications médicales n’existaient pas encore. Les femmes souffrant de douleurs lors des rapports (dyspareunie) faisaient l’objet d’une prise en charge psychologique pour lever de potentiels « blocages ». Cela induisait une forme de culpabilisation, tant elles étaient soupçonnées de ne pas être suffisamment détendues pendant les relations intimes ou de manquer de sentiments pour leur compagnon. Cela niait, en outre, l’existence de toute cause physique.
Essor des indications médicales
Les gels lubrifiants ont intégré la catégorie des dispositifs médicaux en 1993 (classe IIa) par le biais de directive européenne du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Ils ne furent dès lors plus considérés comme des produits cosmétiques. Puis, ils évoluèrent au début des années 2000. Les professionnels de la santé réalisèrent que des femmes remettaient en cause l’observance de leur traitement pour cause de sécheresse. Certaines femmes traitées par radiothérapie et/ou chimiothérapie en cas de cancer utérin ou de cancer du sein, par exemple, étaient en effet extrêmement gênées au quotidien par une sécheresse buccale, oculaire mais aussi intime. Les praticiens se rendirent également compte que la sécheresse intime pouvait induire, outre un inconfort, un certain nombre de problèmes connexes, de type mycose et infection. Enfin, les femmes, qu’elles soient en péri-ménopause ou plus jeunes, faisant fi du fatalisme, parlaient de plus en plus ouvertement à leur médecin ou à leur gynécologue pour continuer à avoir
une vie intime. De nouvelles solutions de gels, indiquées en cas de sécheresse intime et, en outre, destinées à un usage féminin, furent donc conçues : des gels et des huiles à base de silicone. Ils hydrataient les parties intimes mais avaient toutefois l’inconvénient d’être occlusifs et n’agissaient pas nécessairement sur tous les symptômes de la sécheresse intime. D’où l’essor, dans les années 2010 de gels à la fois lubrifiants, hydratants et apaisants, qui soulageaient durablement les femmes souffrant de picotements, démangeaisons, douleurs et brûlures (pendant et en dehors des rapports intimes) causés par la sécheresse. Ces gels de troisième génération côtoient désormais les gels de première et deuxième génération. Certains comportent des principes actifs tels que l’aloe vera, l’acide hyaluronique, des polymères divers etc.
Efficacité, confort, texture
Peu à peu, aux côtés des produits en flacons, sont apparus des produits mono-doses avec applicateurs pour une application intravaginale et une meilleure efficacité. Les canules d’application sont adaptées à la taille et à la physiologie du vagin. Leur embout protecteur en plastique se déclipse à la base et non au bout de l’applicateur. Lisses, elles sont modelées pour ne pas léser les muqueuses. De plus, les monodoses garantissent que le produit soit scellé et sans contact avec les contaminants présents dans l’air et sur les mains afin d’éviter toute contamination bactérienne.
Enfin, un travail important a été réalisé, ces dernières années, sur la texture des gels. En effet, les premiers produits étaient souvent soit très liquides, soit plutôt pâteux et d’aspect blanchâtre. Peu agréables à utiliser, ils nécessitaient le port de protections périodiques au quotidien et généraient parfois des dépôts désagréables pour les femmes. L’innovation a donc porté sur la recherche de produits sous forme de crèmes qui garantissent une certaine adhérence aux muqueuses tout en étant compatibles avec elles et avec les préservatifs ; qui ne soient pas trop huileuses ; et qui soient confortables d’utilisation. La recherche s’est également concentrée sur l’aspect translucide des gels, afin que leur aspect se rapproche de celui des muqueuses.
11. Mammographie
Le mammographe au service du dépistage et du diagnostic
Le diagnostic du cancer du sein est de plus en plus précis et de plus en plus précoce grâce aux progrès des techniques d’imagerie toujours plus poussées.
Une mammographie est une radiographie des seins permettant, à l’aide d’un mammographe, « d’obtenir des images de l’intérieur du sein à l’aide de rayons X et de détecter ainsi d’éventuelles anomalies », rappelle l’Institut national du cancer (INCa). Elle est parfois complétée par deux autres examens d’imagerie :
- une échographie mammaire (en cas de risque modéré et surtout chez les femmes jeunes dont
les seins sont plus denses, ce qui rend la mammographie moins performante) qui utilise des ultrasons pour déterminer la nature liquide ou solide des nodules palpés ou découverts sur la mammographie ;
- plus rarement (en cas de risque plus important, génétique ou familial), un examen d’IRM (Imagerie à résonnance magnétique). Il permet, lui aussi, de faire la différence entre une anomalie bénigne et une anomalie maligne. « Il peut aussi servir à vérifier si le cancer s’est propagé ou s’il y a une récidive locale pour les personnes ayant déjà été traitées pour un cancer du sein », complète l’Institut Curie.
Une mammographie peut être réalisée soit dans le cadre d’un dépistage du cancer du sein soit en présence de symptômes (masse palpée dans le sein, écoulement de sang à travers le mamelon etc.).
Le mammographe se compose d'un générateur de rayons X de faible énergie et d'un système de compression du sein. L'examen consiste à comprimer à tour de rôle les deux seins puis à les exposer à une faible dose de rayons X. La présence d’une masse ou de petits points blancs (foyers de micro-calcifications dont le nombre, la forme et la répartition peuvent varier) permettent de suspecter ou non l’existence d’un cancer.
En 1895, le physicien allemand W. C. Röntgen découvrit le rayon X et en 1913, le chirurgien berlinois A. Salomon radiographia des pièces de mastectomie. En 1949, R.A. Leborgne, à Montevideo (Uruguay), développa une technique de compression du sein avec une exposition aux rayons X de bas voltages pour obtenir des radiographies mammaires. La mammographie moderne, elle, vit le jour en 1965 lorsque le Dr André Willemin (Paris), le Pr Charles Gros (Strasbourg) et la Compagnie générale de radiologie (CGR) mirent au point, pour la première fois, un appareil dédié à l’imagerie du sein : le mammographe, avec un système de compression intégré.
À cette époque, le film argentique était le seul support de lecture des informations. Les détails de l’image, après développement manuel ou développement machine lent, étaient observés à la loupe. Peu à peu, dans les années 70, 80 puis 90, la qualité des films dédiés à la mammographie fut améliorée grâce à l’utilisation d’écrans de réception de meilleure qualité, de grilles anti-diffusantes (améliorant le contraste de l'image radiographique) ainsi que de foyers spécifiques d'émission des rayons X (améliorant la détection des anomalies mammographiques).
De l’argentique au numérique
« Grâce au progrès technologique, le moment du diagnostic a complètement changé, note le Pr Richard Villet, chef du service de chirurgie viscérale et gynécologique de l'Hôpital des Diaconesses depuis 1985. Jusque dans les années 80, les patientes arrivaient à l’hôpital ou au cabinet de leur gynécologue avec une boule au niveau du sein, qu’elles avaient elles-mêmes sentie par palpation ou que leur conjoint ou cardiologue avait repérée. Le diagnostic était donc établi grâce à la réalisation d’une image issue d’une mammographie puis la confirmation ou non de la présence de cellules anormales grâce à une ponction. À cette époque, plus de neuf fois sur dix, la boule ressentie était une tumeur cancéreuse. » Puis, à la fin des années 80, la technique analogique sur film argentique laissa progressivement la place à la technique numérique, plus fiable et plus précise. L’amélioration, de manière générale, de la qualité des mammographies, suscita une forme d’effervescence ouvrant la voie à un diagnostic plus précis, plus précoce et, surtout, au dépistage. « Peu à peu, les femmes prirent l’habitude de faire des mammographies avant d’être malades », poursuit le professeur.
Dans les années 80 et 90, se développa également l’échographie mammaire, permettant de caractériser de mieux en mieux les anomalies présentes à l’intérieur du sein, même sans palpation. « Les patientes venaient en consultation sans masse au niveau du sein, sans symptôme et sans anomalie à l’examen clinique, mais avec une image mammographique et/ou échographique anormale. Elles pouvaient ainsi être prises en charge beaucoup plus tôt, à un stade peu avancé, c’est-à-dire un stade infra-clinique », explique le Pr Villet. En parallèle, les doses d’irradiation diminuèrent, le confort pour les patientes augmenta et les techniques de prélèvements de tissus au niveau du sein se renforcèrent : aux côtés des cytoponctions sous échographie, les micro et macro-biopsies se diffusèrent de manière tout à fait courante à partir des années 90. Ce fut une véritable « révolution », reconnaît le chef du service de chirurgie viscérale et gynécologique de l'Hôpital des Diaconesses (lire chapitre ci-après). On nota une nette diminution de la mortalité des femmes par cancer du sein grâce au dépistage. « Désormais, hormis les cas de tumeurs négligées, la plupart des patientes sont traitées sans avoir de tumeur palpable », relève-t-il.
L’Essor de la tomosynthèse
L'imagerie numérique, de plus en plus performante, autorise de multiples applications : l’aide au diagnostic, le transfert aisé d'images pour le diagnostic et l'enseignement, la vision 3D. La tomosynthèse mammaire numérique vit ainsi le jour en2010-2011. « La mammographie conventionnelle impliquait un cliché de face, de profil et éventuellement, de trois-quarts, détaille le Pr Villet. Toutefois, les anomalies étaient difficiles à visualiser à cause des superpositions de tissus situés dans la zone observée. La tomosynthèse pallie cette difficulté en prenant une série de clichés : le tube à rayons X effectue un arc de cercle de - 30 à 30 degrés au-dessus du sein et le capteur électronique saisit, dans le même temps, une vingtaine d’images radiographiques. La reconstruction tridimensionnelle de l’image offre une image plus claire et plus nette du sein, permettant d’analyser plus précisément la taille, la forme, la localisation et le nombre d’anomalies. » Cette technologie récente de mammographie, en association avec la mammographie 2D conventionnelle, augmente le taux de détection des cancers (+ 30 % environ en comparaison à la mammographie 2D seule) tout en réduisant le nombre d’erreurs.
Un dépistage organisé en France
Depuis 2004, l’ensemble des départements français participent au dépistage organisé du cancer du sein. Le dépistage est aujourd’hui proposé aux femmes âgées de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. L’examen comporte une mammographie des deux seins et un examen clinique. Le taux de participation était de 51,5 % en 2015*.
* Source : INCa
12. Biopsie
Essor des techniques mini-invasives
Cet examen consiste à prélever puis à examiner un fragment de tissu au microscope afin d’apporter un diagnostic avec certitude. Il est largement utilisé en génétique, en neurologie, en hépatologie mais aussi en cancérologie. L’évolution de la taille des échantillons par prélèvement a marqué l’histoire de la biopsie.
La biopsie consiste à prélever un fragment de tissu ou d’organe sur un être vivant afin de l’examiner au microscope. Elle permet le diagnostic d'une anomalie locale (lésion, nodule etc.) ou de symptômes généralisés comme lors d'une maladie systémique. En cancérologie, par exemple, elle permet d’affirmer le diagnostic de cancer, auquel cas les examens sont alors plus poussés pour caractériser la tumeur : stade, type de cancer etc. Les résultats de ces examens, dits examens anatomopathologiques, ont d'importantes répercussions pronostiques et thérapeutiques. S’ils laissent penser que la pathologie détectée a pu s’étendre dans d’autres parties du corps, des examens complémentaires peuvent être prescrits (scanner, IRM etc.). Enfin, au cours du traitement, plusieurs biopsies peuvent être pratiquées pour vérifier l'évolution de la maladie.
Tout type de tissu humain (peau, organe, nerf, muscle, os etc.) peut être prélevé. Plusieurs procédés existent.
La biopsie transcutanée, ou ponction-biopsie, se fait avec une aiguille creuse très fine, une canule ou une sonde, le médecin radiologue se guidant par échographie, radiologie ou scanner. Dans certains cas, comme pour la muqueuse de l'utérus, le praticien réalise une aspiration à travers le col de l'utérus ; dans d’autres cas, comme pour le sein, il procède par forage pour récupérer un fragment long et étroit, une carotte.
La biopsie par endoscopie utilise un endoscope au sein duquel sont glissés une pince à biopsie ou de petits instruments opératoires. L’endoscope est inséré dans l’organisme par les voies naturelles : la vessie (cystoscopie), l'utérus (hystéroscopie) ou le vagin pour voir le col de l’utérus (colposcopie). L’utilisation de cet instrument peut être couplée à celle de réactifs qui colorent les zones suspectes des tissus. On peut aussi introduire un endoscope par une petite incision sur la paroi abdominale (laparoscopie) et pratiquer la biopsie au niveau des organes intra abdominaux (péritoine, ganglions lymphatiques mais aussi ovaires).
La biopsie chirurgicale est pratiquée lorsque la lésion est profonde ou en même temps qu'un geste à visée thérapeutique, après anesthésie locale ou générale. Il peut s’agir d’une biopsie partielle ou d’une biopsie exérèse enlevant la totalité de la lésion ; d’une microbiopsie radio ou écho-guidée (micro-prélèvements) ou d’une macrobiopsie radio-guidée (macro-prélèvements).
La valeur des biopsies repose sur la taille et le nombre des prélèvements, le choix de la zone de prélèvement (éviter les zones nécrotiques ou hémorragiques ainsi que les prélèvements trop superficiels sur la peau ou une muqueuse) et la bonne préservation des tissus.
Guillaume-Benjamin Duchenne, médecin neurologue français, inaugura, en 1865, la technique de la biopsie en inventant un instrument permettant de prélever puis d’analyser des échantillons de tissu à l'intérieur du corps de ses patients sans attendre le décès de ces derniers. L’outil était composé d’une tige cylindrique comportant une petite cavité permettant de récolter un peu de tissu musculaire ainsi que d’un dispositif coulissant et tranchant afin de sectionner le tissu ainsi prélevé, de l’enfermer et de le retirer sans accrocher les tissus traversés. Cet « emporte-pièce histologique » lui permit, du vivant de ses patients et sans leur causer trop de douleurs, d’aller chercher de petits fragments dans la profondeur de leurs muscles afin d’étayer la description de la maladie neuromusculaire aujourd’hui connue sous le nom de myopathie de Duchenne. Ainsi naquirent les premières ponctions-biopsies musculaires. À la fin des années 30, les premières biopsies transcutanées d'organes (notamment du foie) furent pratiquées même si ce n’est que bien plus tard qu'elles entrèrent dans la pratique médicale courante.
De la cytologie à l’histologie
Dans les années 50-60, les cytoponctions, réalisées à l’aide d’aiguilles hypodermiques se développèrent. Elles permirent, sans anesthésie, le prélèvement de quelques cellules et d’un peu de liquide contenus dans un nodule ou une lésion. Ces prélèvements étaient ensuite déposés manuellement sur une lame avec une seringue puis analysés au microscope pour un examen cytologique.
Puis, aux côtés des prélèvements cytologiques, les prélèvements histologiques, à l’aide d’une aiguille, d’un endoscope, par frottis ou encore par chirurgie, se généralisèrent. Certaines procédures se spécifièrent en fonction des tissus. À titre d’exemple, les prélèvements de tissus et de muqueuses au niveau du col de l’utérus, de l’utérus ou même du vagin, par le biais de petites canules, furent facilités dans les années 80 grâce à l’essor de l'hystéroscopie. Dans le même temps, apparut la technique de la microbiopsie, pour le diagnostic du cancer du sein : trois à quatre prélèvements de tissus mammaires étaient effectués sous anesthésie locale et sous contrôle mammographique (microbiopsie sous stéréotaxie) ou échographique. Elle permettait la caractérisation de la lésion (bénigne ou maligne). Cette technique fut facilitée par la création de pistolets automatiques munis d’une aiguille, réutilisables ou jetables.
Réduction des interventions chirurgicales inutiles
Le cancer du sein étant le plus fréquent chez la femme, l’innovation a été dense dans ce domaine. Ainsi, au début des années 2000, la macrobiopsie du sein, vit le jour. Les aiguilles furent remplacées par des sondes insérées dans l’organisme à travers une petite incision et capables de prélever des tissus de 4 à 5 mm de diamètre sur 2 cm de long, sans abîmer la peau autour de la lésion. De plus, les médecins purent effectuer une douzaine de prélèvements par intervention. Ces macroprélèvements, effectués sous guidage radiographique, permettaient d’améliorer le diagnostic, de réduire le nombre de faux négatifs, de repérer des marqueurs génétiques, de mieux définir le traitement à proposer à la patiente et d’éviter, si possible, l’ablation du sein. « La généralisation des techniques de macrobiopsie stéréotaxique permit de réduire les interventions chirurgicales inutiles, c’est-à-dire les interventions pour des lésions qui ne sont pas cancéreuses, rapporte le Pr Emmanuel Barranger, chef du département de chirurgie oncologique gynécologique et mammaire au Centre Antoine Lacassagne (Nice). Elles assurent en effet une meilleure discrimination entre les lésions cancéreuses et les lésions bénignes. »
Un Large arsenal de diagnostic pré-opératoire
Ces techniques persistent à l’heure actuelle. « Par priorité, si l’échographie révèle une anomalie, une masse par exemple, une microbiopsie sous échographie sera effectuée, souligne le Pr Richard Villet, chef du service de chirurgie viscérale et gynécologique de l'Hôpital des Diaconesses. Si l’échographie ne présente pas de résultat suffisamment net, une macrobiopsie sous radiographie sera envisagée. » Par ailleurs, la Biopsie du ganglion sentinelle (BGS), intervention pratiquée pour trouver et enlever le premier ganglion lymphatique (au creux de l’aisselle) vers lequel le cancer du sein est le plus susceptible de se propager, « fut également, au début des années 2000 en France, une avancée majeure qui permit de réduire le nombre de curage axillaire et les complications de la chirurgie du sein », souligne le Pr Barranger. « Grâce à
l’ensemble de ces techniques, nous disposons d’un large arsenal diagnostic pré-opératoire », se félicite-t-il.
Quelles voies d’avenir ?
Ces dernières années, certains systèmes ont permis, sous stéréotaxie ou sous échographie, « l’exérèse monobloc complète des anomalies mammographiques de petite dimension », complète le Dr Jean-Yves Seror, médecin radiologue à Paris. Comme il l’explique, ces instruments chirurgicaux, à usage unique, étaient munis d’une aiguille de localisation et d’une canule de forage ; « cette technique, proche de la biopsie chirurgicale, permet de passer du diagnostic à la thérapie ». En parallèle, « d’autres techniques thérapeutiques furent mises au point, utilisant le chaud - les ultrasons ou le laser qui chauffe et brûle le tissu – ou encore, le froid – la cryothérapie – pour détruire la lésion ou la tumeur, détaille le Dr Seror. Toutefois, ces techniques n’apportent pas la preuve histologique du traitement. Elles impliquent donc le recours à l’imagerie pour vérifier si la technique a été efficace », poursuit-il. Ces techniques sont, en outre, encore expérimentales. Certains centres les testent sur des lésions du foie et du poumon mais pas encore sur le sein ou l’utérus. Des tests cliniques complémentaires jugeront de leur efficacité.
L’innovation s’oriente, de manière générale, vers une voie diagnostique moins invasive : celle du diagnostic du sang qui permettra peut-être une « pré-évaluation » des lésions et, éventuellement, un choix plus fin du type de biopsie à réaliser. La voie thérapeutique est également explorée : celle du traitement percutané thérapeutique, c’est-à-dire la microchirurgie afin d’éviter la chirurgie lourde.
Une biopsie propre à la femme enceinte
Face à des antécédents génétiques familiaux ou des anomalies détectées lors des examens prénataux, une biopsie peut être proposée aux femmes enceintes.
Il s’agit du prélèvement, à la fin du premier trimestre de la grossesse, d’un petit fragment du tissu qui deviendra le placenta. L’examen est effectué entre la 11e et la 13e semaines d’aménorrhée.
Il permet de diagnostiquer des pathologies telles que la mucoviscidose, la myopathie, l’hémophilie ou encore la trisomie 21. Le prélèvement peut être réalisé soit par ponction à travers l’abdomen à l’aide d’une aiguille fine, sous contrôle échographique ; soit parfois via le col de l’utérus à l’aide d’une pince gynécologique.
13. Thérapie par ultrasons focalisés de haute intensité
Une alternative douce à la chirurgie pour le traitement de tumeurs bégnines du sein et de l’utérus
Des technologies de pointe utilisant les ultrasons thérapeutiques assurent un traitement précis, individualisé et non invasif des tumeurs situées notamment au niveau du sein et de l’utérus.
Les ultrasons focalisés de haute intensité (Ufhi, ou Hifu en anglais) peuvent être utilisés pour obtenir l’ablation thermique de tumeurs bénignes (fibromes au niveau du sein ou de l’utérus, nodules thyroïdiens) voire malignes (cancer de la prostate, du foie, de la thyroïde). Cette technique constitue une alternative à l’opération chirurgicale (retrait de la tumeur) et a pour avantage, après une intervention en ambulatoire, de ne laisser aucune cicatrice.
La technique repose sur l’utilisation d’ondes de haute intensité (10 000 fois plus élevée que pour une échographie) qui, concentrées sur la zone tumorale, induisent un échauffement rapide entraînant la coagulation des tissus traités puis leur nécrose. L'action, très ciblée, épargne les tissus sains alentours. Elle ne laisse place qu’à un amas de tissu résiduel. Elle est généralement guidée grâce à l’Imagerie par résonance magnétique (IRM) ou l’imagerie ultrasonore.
Le premier générateur d'ultrasons sous forme de sonar vit le jour pendant la première guerre mondiale, grâce aux travaux du physicien français, Paul Langevin, et du scientifique russe, Constantin Chilowski. Les effets biologiques des ultrasons, notamment l'effet thermique et la destruction tissulaire, furent décrits en 1927 par les chercheurs américains Alfred L. Loomis et Robert W. Wood. Dans les années 30, les ultrasons, non focalisés et de faible intensité, furent notamment utilisés en physiothérapie. Puis, en 1942, le Dr John G. Lynn démontra pour la première fois l’intérêt du recours aux ultrasons focalisés de haute intensité, en l’occurrence pour l'ablation de tissus cérébraux. Les frères Francis et William Fry développèrent cette technique dans les années 50 et 60 et effectuèrent des premiers tests cliniques du traitement par Hifu de la maladie de Parkinson. Par la suite, de nombreuses études sur la thérapie par Hifu furent menées de par le monde, donnant lieu à de nouveaux dispositifs ultrasonores ainsi qu'à un grand nombre d'applications médicales (comme les fibromes utérins, les fibromes du sein, les nodules thyroïdiens mais aussi, depuis le milieu des années 90, les cancers de la prostate et du foie non métastatiques). Peu à peu, avec les progrès de l’imagerie et de l’échographie, de nouveaux dispositifs permirent de guider en temps réel les ultrasons focalisés de haute intensité.
L’Essor de l’écho-guidage
De fait, certains systèmes combinent, depuis le début des années 2000, les ultrasons focalisés de haute intensité et l’IRM fonctionnelle. D’autres systèmes, depuis 2013, proposent un guidage par échographie (échothérapie). Ces dispositifs, robotisés, assurent une thermo-ablation non invasive précise et contrôlée en temps réel. Ils permettent de traiter des tumeurs bénignes, notamment au niveau du sein et de l’utérus mais aussi au niveau de la thyroïde : ils réduisent en effet leur volume et font disparaître leurs symptômes. Les derniers modèles garantissent un traitement réalisé de manière séquentielle, alternant des périodes d’impulsion (environ 4 secondes) et des périodes de pause (10 à 20 secondes) pour laisser les tissus refroidir, c’est-à-dire éviter une accumulation de chaleur sur la peau et un dommage potentiel. Depuis 2015, certains appareils incorporent même un système de déplacement circulaire des têtes de traitement, destinés à traiter des lésions plus grosses et de manière plus rapide. Les appareils incluent également une meilleure qualité d’image pour une meilleure visualisation en temps réel voire, pour quelques-uns, la 3D.
Vers le traitement de tumeurs malignes ?
Ces technologies ouvrent des perspectives en oncologie en association avec la chirurgie ou la radiothérapie. Certaines études, notamment en Allemagne, sont en cours pour étudier la faisabilité de l’échothérapie dans le traitement du cancer, par exemple. Les avantages seraient nombreux, en particulier parce que ce traitement est complètement non invasif. Certaines limites subsistent encore à l’heure actuelle : en effet, si les thérapies par ultrasons focalisés de haute intensité, guidés par l’imagerie, réduisent la tumeur, elles ne la font pas disparaître.
14. Cancer du sein
Une chirurgie toujours plus conservatrice grâce aux dispositifs médicaux
L’accès à du matériel innovant, facilitant le diagnostic, l’examen, le partage des informations mais aussi la chirurgie, a bouleversé le traitement du cancer du sein.
La chirurgie est, dans le traitement du cancer du sein, le plus souvent réalisée en premier et peut être suivie d’une chimiothérapie et/ou d’une radiothérapie et/ou d’une hormonothérapie. Elle vise à enlever les tissus atteints par les cellules cancéreuses. Elle est parfois précédée d’un traitement médical destiné à réduire la taille de la tumeur afin de faciliter l’intervention.
Il existe deux types d’intervention chirurgicale :
- la chirurgie mammaire conservatrice (tumorectomie ou mastectomie partielle) qui implique le retrait de la tumeur et d’une petite partie des tissus qui l’entourent de façon à conserver la plus grande partie du sein. Elle est « privilégiée aussi souvent que possible » et « est toujours complétée d’une radiothérapie », rappelle l’Institut national du cancer (INCa).
- la chirurgie mammaire non conservatrice (mastectomie) au cours de laquelle « le chirurgien enlève le sein, le mamelon ainsi que le revêtement des muscles du thorax (fascia pectoral) » et « laisse en place les ganglions lymphatiques, les nerfs et les muscles du thorax », détaille l’INCa.
Une mastectomie totale (préventive), qui consiste à ôter chirurgicalement la totalité du tissu mammaire, peut être proposée chez les femmes à haut risque de contracter un cancer.
Quelle que soit l’intervention préconisée, le chirurgien opère de façon à préserver la peau, à diminuer les sécrétions sanguines et l’écoulement de lymphe et à favoriser la cicatrisation et la récupération postopératoire. Les progrès technologiques facilitent l’atteinte de ces objectifs.
Pendant très longtemps et ce, depuis l’Antiquité, les médecins n’avaient à leur disposition qu’un seul traitement : l’ablation de la tumeur. Les actes d’amputation, très larges, incluaient les ganglions et étaient réalisés « sans anesthésie et sans antisepsie », détaille la Ligue contre le cancer, causant très souvent des infections et des hémorragies mortelles. Puis, les techniques chirurgicales s’améliorèrent. L’anesthésie générale fit son apparition en 1846. En outre, le Dr W.S. Halsted mit au point, dès 1890, la technique d’ablation radicale du sein, ou mastectomie totale élargie, impliquant l’ablation du sein, des muscles sous-jacents et des ganglions lymphatiques situés sous le bras.
Chirurgies plus conservatrices
Dans les années 60, D.H. Patey introduisit la technique de la mastectomie radicale modifiée. « Le sein était retiré mais les muscles pectoraux, situés derrière, étaient conservés », détaille le Pr Richard Villet, chef du service de chirurgie viscérale et gynécologique de l’Hôpital des Diaconesses. À partir de 1975, dès lors que la taille de la tumeur était inférieure à 3 ou 5 cm, un traitement conservateur devenait possible, combinant une tumorectomie et une radiothérapie. Les mastectomies (avec reconstruction éventuelle ensuite) étaient réservées à certains cas seulement.
« En outre, depuis 2000 en France, la chirurgie ganglionnaire a connu un important essor », poursuit le Pr Villet. Celle-ci consiste à prélever le ganglion sentinelle (premier ganglion ou groupe de ganglions, au niveau de l’aisselle, qui draine le sein et vers lequel les cellules cancéreuses se déplacent prioritairement). Son analyse au microscope met en évidence une dissémination (ou non) de la tumeur et conditionne la suite des traitements. Elle permet également d’éviter le curage axillaire (creux de l’aisselle) systématique et de préserver au maximum cette zone. Les techniques chirurgicales les plus récentes visent à réaliser une mastectomie avec préservation de l’aréole et du mamelon, laquelle constitue encore à ce jour un vrai défi. L’objectif est de rendre la prise en charge moins lourde et moins visible pour les patientes.
Essor des bistouris électriques
La chirurgie oncologique du sein a considérablement évolué aux XXe et XXIe siècles grâce à l’essor de nouveaux outils permettant des interventions chirurgicales plus simples, plus rapides et plus précises pour les professionnels de santé, avec des résultats post-opératoires optimisés et moins traumatisants pour les patientes (diminution des échauffements ou brûlures des tissus, réduction du nombre de séromes etc.). Parmi les avancées significatives : le bistouri électrique, apparu en 1926, permit de réaliser une section efficace et précise, avec une hémostase plus contrôlée, notamment en chirurgie mammaire. Dernière évolution en date,
en 2016, après l’essor du bistouri monopolaire, bipolaire et ultrasonique : le bistouri chirurgical au plasma par radio fréquence pulsée. Ce dispositif est indiqué pour l’incision et la coagulation des tissus mous, notamment en cas de chirurgie plastique et reconstructrice (lire chapitre sur les prothèses mammaires), améliorant ainsi l’efficacité du geste chirurgical grâce à un tracé plus net et une dissection plus fine. L’incision effectuée avec ce dispositif provoque moins de lésions thermiques par rapport à l’utilisation du bistouri électrique traditionnel. Elle réduit la durée et le volume de drainage, la réponse inflammatoire tout en améliorant la cicatrisation. Ce dispositif peut en outre être utilisé pour effectuer l’incision cutanée initiale.
Il utilise de très brèves impulsions électriques (de l’ordre de 40 µs) d’énergie haute fréquence pour produire un champ de plasma sur le bord d’une fine électrode (12,5 µm). La puissance, la vitesse et la température des impulsions sont réglables. Le cycle court de l’impulsion de radio fréquence et le bouclier de protection thermique permettent d’opérer à des températures inférieures à celles de l’électrochirurgie traditionnelle (40-170°C contre 200-350°C). Au même titre que les nouvelles techniques opératoires, il améliore la sécurité de l’acte chirurgical.
15. Traitement du prolapsus génital
De l’urologie à la gynécologie
Les bandelettes sous-urétrales, utilisées pour traiter l’incontinence urinaire, ont inspiré les industriels et les chirurgiens urologues ou gynécologues. Les implants de renfort en forme de filet se sont révélés efficaces pour traiter les troubles de la statique pelvienne, les prolapsus génito-urinaires et l’incontinence urinaire d’effort.
Le prolapsus génital ou génito-urinaire correspond à ce que l’on appelle, en langage courant, une « descente d’organes ». Favorisé, chez la femme, par les accouchements nombreux et/ou difficiles ou encore par le vieillissement et l’obésité, il se caractérise par le glissement vers le bas, transitoire ou permanent, d’un ou plusieurs organes situés dans le bassin : la vessie (on parle alors de cystocèle), le rectum (rectocèle) mais aussi l’utérus (hystérocèle). Ceux-ci appuient et déforment la paroi vaginale, jusqu’à s’extérioriser au-delà de la vulve, lorsque le plancher pelvien, ou périnée, se relâche ou se distend.
Le prolapsus entraîne, selon les cas, une gêne dans le bas-ventre, une boule au niveau de la vulve, des troubles urinaires, des troubles sexuels (gêne, douleur, saignements etc.), voire, plus rarement et plus tardivement, des troubles de la défécation. Il peut être soigné par une meilleure hygiène de vie (perte de poids, activités sportives plus douces comme la natation), une rééducation pour remuscler le périnée, la pose d’un pessaire (dispositif souple intra-vaginal, généralement en forme d’anneau, inséré autour du col de l’utérus).
Une intervention chirurgicale peut être envisagée lorsque la patiente est gênée par ces symptômes. Celle-ci consiste à poser, dans l’organisme, une prothèse pour soutenir ou suspendre les organes. Le chirurgien peut aussi, éventuellement, proposer aux patientes de retirer, en partie ou en totalité, leur utérus en cas de prolapsus utérin prononcé ou de pathologie utérine associée, voire les trompes et/ou les ovaires à titre préventif de cancer.
Les dispositifs médicaux implantables destinés à traiter le prolapsus génital sont choisis en fonction de l’état de santé de la patiente, de son âge et de son désir éventuel de grossesse ultérieure. Ils sont posés par voie haute (abdominale) ou basse (vaginale).
Par voie haute, le chirurgien suspend l’organe qui a glissé à un élément solide du bassin ou de la colonne vertébrale, en utilisant une prothèse (promonto-fixation). Il procède par incision classique abdominale (laparotomie) ou par chirurgie mini-invasive (cœlioscopie). C’est la technique la plus souvent utilisée chez les femmes jeunes pour traiter un prolapsus. Cette voie est privilégiée en cas d’inaccessibilité vaginale, de récidive ou de risque de récidive du prolapsus.
Par voie basse, le chirurgien insère dans la paroi vaginale, via les voies naturelles, un filet de renfort pour soutenir l’organe. Il peut, en cas d’incontinence urinaire associée, positionner une bandelette sous l’urètre ou une prothèse synthétique porteuse de bras pour soutenir les organes impliqués dans le prolapsus.
« Avant les années 2000 et depuis le XIXe siècle, les prolapsus génitaux étaient traités chirurgicalement par voie vaginale, explique le Pr Bernard Jacquetin, ancien chef du service de gynécologie-obstétrique du CHU Estaing de Clermont-Ferrand, devenu consultant en pédagogie chirurgicale, en recherche clinique et en innovations diagnostiques et thérapeutiques. Les propres tissus des patientes étaient utilisés pour renforcer les tissus pelviens distendus. Cette technique ne nécessitait aucun matériel ajouté, limitant ainsi le risque de complications éventuelles. Toutefois, les patientes faisant des prolapsus ont souvent une prédisposition génétique à cela : la qualité de leurs tissus est altérée, en particulier celle de leur tissu collagène ou conjonctif. L’utilisation de leurs propres tissus exposait donc les patientes à des récidives, parfois assez précoces. Celles-ci survenaient dans 40 à 50 % des cas dans les 5 ans après l’intervention. Certaines patientes étaient ainsi opérées 3 à 4 fois pour le même motif. De nouvelles solutions étaient nécessaires. »
L’Essor des prothèses de soutien
En parallèle, dès la fin du XIXe siècle, d’autres techniques chirurgicales se développèrent par voie abdominale. Ces interventions étaient beaucoup plus lourdes puisqu’elles consistaient à ouvrir l’abdomen des patientes pour « tirer vers le haut » et suspendre leur utérus et leur vagin. Les fixations étaient assurées par des fils. Puis, dans les années 50, ces techniques furent associées à l’utilisation de prothèses de soutien. Fixées entre la vessie et la paroi antérieure du vagin et, éventuellement, entre le rectum et la paroi postérieure du vagin, ces prothèses étaient ensuite fixées à un ligament très solide situé en avant de la colonne vertébrale, au niveau du promontoire. Ces techniques furent appelées « techniques de promontofixation ». Les premières furent décrites en 1957 par André Ameline et Jacques Huguier. Initialement réalisées par voie chirurgicale, elles furent peu à peu réalisées par cœlioscopie dès le début des années 90. La première description d’une promontofixation par cœlioscopie eut ainsi lieu en 1993. Ces procédures, qui existent toujours aujourd’hui, sont parfois exécutées par cœlioscopie robot-assistée.
Le tournant des années 2000
« Il y eut une nouvelle évolution très nette avec la mise au point des renforcements prothétiques placés par voie vaginale étant donné le succès des bandelettes sous-urétrales placées par voie vaginale », détaille le Pr Bernard Jacquetin. Ces techniques, alternatives à la promontofixation par voie abdominale, consistent à fixer les organes pelviens sur une ou deux prothèses de renforcement, une antérieure et/ou une postérieure, par une simple ou double fixation, par les voies naturelles. Les prothèses utilisées prirent, dès le début, l’aspect de treillis (« hamacs pelviens » en termes médicaux). Toutefois, les procédures et le lieu exact de fixation des renforts des organes pelviens étaient très variables en fonction des chirurgiens. « Avec l’aide du Dr Axel Arnaud, chirurgien digestif, et d’industriels, huit chirurgiens gynécologues français de renom et moi-même avons travaillé de concert, dès juin 2000, pour analyser les différentes techniques utilisées et définir une technique standardisée et reproductible, utilisant un renfort transvaginal », raconte le Pr Jacquetin.
Fut ainsi officiellement mise au point, en 2004, la technique dite « Transvaginal mesh » (TVM). Un brevet pour cette technique fut déposé aux États-Unis le 7 novembre 2006. Elle reposait sur la pose par voie vaginale de prothèses sous forme de renforts en polypropylène : une prothèse antérieure maintenue en place à travers le trou ischio-pubien (ou trou obturateur, situé dans l’os iliaque) ; une prothèse postérieure positionnée à travers le ligament sacro-épineux ; voire une prothèse totale, en cas de prolapsus complet, pour les patientes dont l’utérus avait été enlevé. Des aiguilles permettant l’insertion des prothèses ainsi que des gaines pour protéger les bras des prothèses furent mises au point. La TVM connut rapidement un engouement mondial.
Une Technique de pointe
« Un gros travail a été réalisé pour enseigner cette technique et bien expliquer la manière de positionner les prothèses grâce, notamment, à la réalisation de vidéos d’anatomie en trois dimensions », détaille le Pr Bernard Jacquetin. Cette procédure, performante mais pointue, devait en effet être réalisée par des chirurgiens gynécologues correctement formés. « Elle n’était et n’est toujours pas sans risque, insiste l’ancien chef de service du CHU de Clermont-Ferrand. Le risque le plus fréquent est l’exposition, c’est-à-dire l’issue de la prothèse dans la cicatrice vaginale. Cette complication, qui entraîne quelques pertes désagréables et/ou des douleurs pendant les rapports sexuels, peut être corrigée très aisément, parfois lors d’une simple consultation. Elle peut surtout être évitée grâce à la profondeur de la dissection lors de la pose de la prothèse. En effet, la dissection ne doit pas être superficielle : les chirurgiens doivent aller sous le fascia, c’est-à-dire aller au contact des organes. À défaut, les risques d’exposition prothétique peuvent grimper à 30 % contre moins de 3 % en principe. » Les autres risques associés à la TVM sont, comme pour toute implantation de corps étrangers dans l’organisme, des risques de réaction inflammatoire, variables d’une patiente à l’autre. « Après une telle réaction, certaines patientes entrent dans un processus de cicatrisation avec sécrétion importante de fibrine autour de la prothèse. Celle-ci se rigidifie, se contracte, ce qui cause des douleurs et d’autres désagréments, explique le Pr Jacquetin. La solution est alors l’ablation partielle ou totale de la prothèse. »
Pour limiter ces risques, la forme des prothèses, dont les bords étaient coupés au laser pour réduire les aspérités, a été adaptée et leur taille réduite dès 2012. « Nous avons montré, dans une étude prospective lancée dès 2005 aux États-Unis et en France qu’une fois la première année passée au cours de laquelle des complications restaient possibles, les résultats anatomiques consécutifs à la pose de prothèses selon la technique TVM étaient stables à 2 et 5 ans, explique le Pr Jacquetin. Nous poursuivons cette étude pour avoir un état des résultats à douze ans. »
Aujourd’hui, plusieurs entreprises commercialisent ce type de prothèses. Elles sont plus ou moins utilisées selon les pays. Elles sont très répandues en France et en Allemagne, par exemple, contrairement aux États-Unis, aux Pays-Bas et à l’Écosse. Certains nouveaux modèles cumulent une fixation de soutien de la vessie et une autre de soutien de l’apex vaginal. Par ailleurs, « la tendance actuelle n’est plus de passer à travers le trou obturateur mais de fixer les prothèses au niveau de structures aponévrotiques proches du trou obturateur. Des dispositifs variés tendent à faciliter ces fixations », complète le Pr Jacquetin. Les prothèses sont parfois fixées sur d’autres éléments anatomiques pelviens, comme des ligaments ou arcs.
Qualité et sécurité
Les autres dispositifs de traitement du prolapsus continuent, quant à eux, de se perfectionner. Posés par voie haute ou basse, ils ont vu leur structure et leur qualité évoluer. Les treillis prothétiques, par exemple, auparavant souvent multitricotés, non tissés et enduits de silicone, sont, depuis le début des années 2000, pour la plupart, tissés et en polypropylène monofilament pour réduire les frottements avec les tissus des organes, les nécroses et les infections mais aussi pour éviter les expositions et/ou érosions. Les tissus synthétiques, perméables, laissent désormais davantage passer les macrophages, les anticorps et les fluides au sein de l’organisme. Plus solides, ils limitent aussi les risques de déchirure des prothèses.
Depuis le début des années 2000, les treillis prothétiques revêtent des formes particulières en fonction de l’endroit où ils sont fixés et en fonction de la manière dont ils sont posés (soit par voie chirurgicale et voie cœlioscopique, soit par voie naturelle). Ils seront ainsi prédécoupés ou, bien souvent, rectangulaires pour être ajustés à la forme et à la taille souhaitées. Une large palette de choix est à la disposition des chirurgiens. Enfin, des systèmes d’ancrage, disposés aux extrémités des treillis, facilitent depuis 2008 la fixation à distance des dispositifs dans l’organisme.
Le saviez-vous ?
Dans l’Antiquité, le prolapsus était diagnostiqué probablement par le toucher vaginal. Des traitements sont décrits pour replacer l’utérus. Ceux-ci visent à « inciter l’utérus » à revenir à sa place plus qu’à le contraindre mécaniquement. Pour cela, ils reposent sur les fumigations de substances à l’odeur agréable pour attirer l’utérus ou à l’odeur fétide pour le repousser (remèdes jetés sur des pierres chauffées ou des charbons), les injections vaginales ou encore les pessaires. Cependant, un moyen mécanique déjà avait été proposé par Hippocrate : la succussion… Il s’agissait d’attacher par les pieds la patiente sur une échelle, tête en bas et de secouer cette échelle pour provoquer la réintégration des organes !